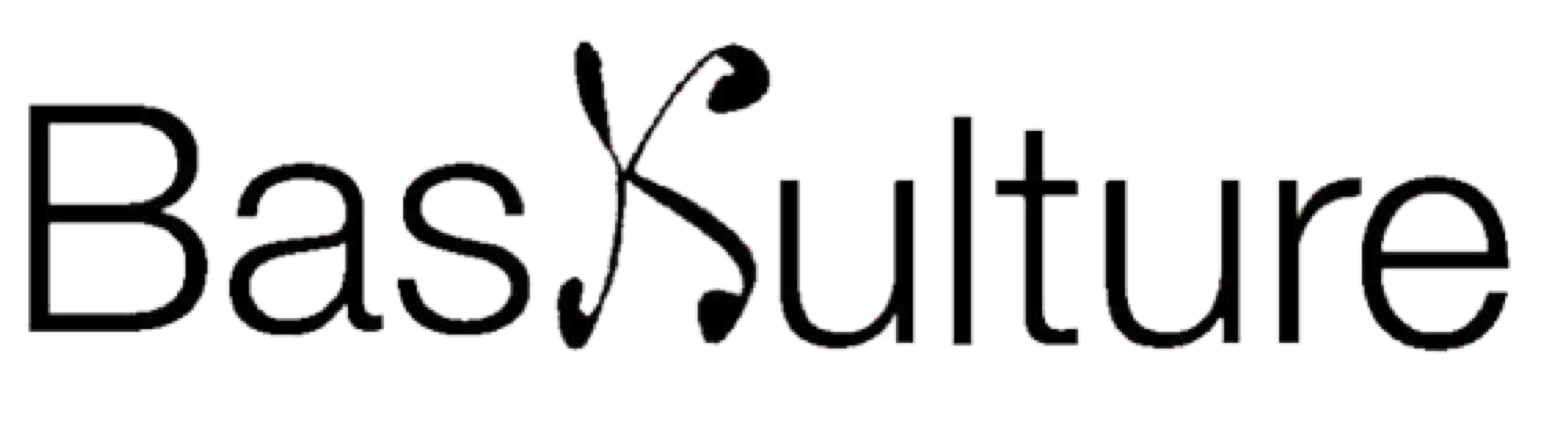(photo de couverture : vers l'Alto del Perdón ; regard en arrière)
"On apprend l'eau – par la soif
Et la terre – par les Voyages en mer –
La Passion – par les affres,
Et la paix – par les récits de guerre –
L'Amour – par la Mort
Et les oiseaux – par l'Hiver."
Emily Dickinson, in "Escarmouches", Orphée La Différence, 1992, p.31
Il est des vérités qu’aucun ne peut fléchir,
Des raisons de la grâce, invisibles et pures,
Que l’ange, tout en feu, ne saurait éclaircir,
Tant leur source en Dieu seul fuit les créatures.
Ni l’ange dans le Verbe aux limpides murmures,
Ni les saints, ni les voix qui montent du désir,
Ne virent ces desseins cachés dans les figures,
Mais les virent s’ouvrir, jaillir, puis resplendir.
Car tel l’architecte en sa pensée profonde
Forme un palais secret que nul œil ne devine,
Ainsi Dieu tient en Lui la sagesse du monde.
Mais quand l’œuvre paraît, quand la maison s’illumine,
On comprend non par elle, mais dans ce qu’elle fonde :
La forme fait parler la vérité divine.
1. "Là où le chemin du vent rencontre celui des étoiles"
Je quittai Pampelune par son pont médiéval (Puente de la Magdalena près de l'université de Navarre) et les arbres en fleur des jardins du Campus.
Me voici dans la Sierra du Perdón, à 770 m d'altitude, passage obligé des pèlerins venant de Pampelune et se dirigeant vers Puente la Reina dans la vallée d'Izarbe (Valdizarbe en espagnol ou Izarbeibar en basque).
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, se dressaient ici une chapelle dédiée à la Vierge du Perdón et un hôpital pour les pèlerins. Il n’en reste aujourd’hui qu’un mur solitaire, comme un vestige veillant sur le passage. La tradition raconte que ceux qui franchissaient ce sommet obtenaient le pardon de leurs fautes — et si la mort les surprenait en chemin, leur salut spirituel était assuré pour le reste du voyage.
Le parc éolien du Perdón, premier du genre en Navarre, s’élève aujourd’hui sur ces hauteurs : quarante générateurs de 40 mètres, aux pales longues de 20 mètres, tournent dans le vent comme autant de vigies blanches.


C’est après l’implantation du parc, en 1996, que le sculpteur navarrais Vicente Galbete Martinicorena conçut une sculpture monumentale en métal d’aspect rouillé consacré au chemin de Saint-Jacques, sous le titre évocateur : "Là où le chemin du vent croise celui des étoiles" (Donde se cruza el camino del viento con el de las estrellas).
L’œuvre figure l’évolution du pèlerinage au fil des siècles : quatorze silhouettes de fer, grandeur nature, avancent en procession. Certains marchent, d’autres chevauchent, d’autres encore portent sur leur dos la fatigue des siècles. À travers elles, c’est toute l’histoire du chemin qui traverse la crête, humble et droite, vers l’ouest.
2. La légende du Haut-Pardon (Alto del Perdón)
"Yo Maestro Gonzalo de Berceo nomnado iendo en romería caesci
en un prado verde e bien sencido de flores bien poblado,
lugar cobdiciadero para omne cansado."
Gonzalo de Berceo (1)
Il y a un moment, sur le chemin, où l’on ne cherche plus rien. Où l’on marche sans raison. Le vent a cessé. Le ciel est là, un bleu immense et vide. Et l’on a soif. Pas seulement dans la bouche. Non. Mais une soif plus ancienne. Comme un creux dans le cœur. Quelque chose manque. Ou quelqu'un. On ne sait pas quoi ou plutôt qui. Si, en vérité, je sais.
Ce matin-là, j’étais seul. Et j’ai eu soif. Soif de cette eau qui n’est pas cherchée, mais reçue au creux d’une offrande. Elle ne désaltère pas d’abord le corps — elle désaltère ce qui, en nous, voudrait mourir sans bruit. Comme dans ce désert du Petit Prince, où le puits chantait — parce qu’on l’avait creusé avec le cœur. Cette eau-là porte le souvenir du visage de la personne aimée. Elle contient la fidélité de ce qui a été promis sans parole. Tel le pèlerin de la légende, sauvé de la soif par la source surgie sous l’œuvre de saint Jacques — là même, en Navarre, où l’on murmure encore le nom de la Fuente Reniega.
Un pèlerin, dit la légende,
Marchait au cœur d’une journée ardente.
Il allait vers le Pont royal,
Sous le soleil cruel et fatal.
Un jour brûlant, la soif aux lèvres,
Un pèlerin, usé, s’élève
Jusqu’au plateau du Haut-Pardon,
Sous le ciel dur, sans horizon.
Le vent s’est tu. L’air est de pierre.
Son pas vacille. Il désespère.
Il cherche l’eau, un peu d’ombre,
Mais tout autour, le vide sombre.
C’est là qu’un homme, noble et clair,
Sort lentement d’un bois de fer.
Son cheval brille, sa voix est douce —
Une promesse coule à sa bouche :
- « Tu veux de l’eau ? Tu n’as qu’un mot.
Dis que ton Dieu n’est qu’un fardeau.
Éteins ce nom, abandonne-le —
Et je t’offrirai ce que tu veux. »
Le pèlerin, le souffle court,
Se tait longtemps, regarde alentour.
Il sent en lui le cri du corps,
Le cœur battant comme un tambour.
Mais dans ce cri, très bas, très pur,
Quelque chose murmure : « Endure. »
Il lève les yeux vers le Très-Haut,
Et dit : « Non. Garde ton cadeau. »
L’homme s’avance, un peu plus pâle,
Et dit : « Garde ton Dieu loyal.
Mais renonce à cette Mère-là -
Marie ne te répondra pas. »
Le ciel chancelle. L’air devient noir.
Le pèlerin sent son espoir
Fondre dans la chaleur maudite.
Mais dans sa main, une prière écrite :
« Je te salue, Reine du Ciel,
Flamme très douce aux pas fidèles. »
Il tient bon. L’homme sourit, froid :
— « Alors renie Jacques, et bois. »
Mais là, le marcheur tombe à genoux.
Plus de défense. Plus de verrou.
Il n’a plus que ce fil vivant :
Un nom, un souffle, un abandon lent.
Il dit : « Marie… » — puis se brise,
Et en silence agonise.
Plus de prière, plus de recours,
Que la poussière et le grand jour.
Un pas s’avance, sûr, sans bruit,
Dans l’air coupé par l’agonie.
Son manteau blanc frôle la pierre.
C’est Jacques, né d'une prière.
Il tend une coquille d’or
Pleine d’une eau qui sent le port.
Le pèlerin, d’un geste franc,
Boit. Et son âme s'ouvre vers l'avant.
À ses pieds, l’herbe devient source.
L’eau jaillit vive, trace sa course.
Depuis ce jour, dans ce vallon,
On parle encor du Haut Pardon.
3. Le Foulard du Perdón
I. Descente – Le souffle court
Je l’avais au départ, autour du cou serré,
Témoin silencieux de mes pas mesurés.
Au sommet du Perdón, le vent m’a traversé —
Le foulard n’est plus là, mon cœur est transpercé.
Je descends, inquiet, dans l’ombre des cailloux,
Le souffle court, le pas comme un marteau fou.
Chaque pierre me heurte, chaque ronce murmure :
« Il est perdu, ton signe, il est dans la brûlure. »
Je scrute, je trébuche, je cherche sans repos,
Le regard affamé, le front plein de sanglots…
Puis soudain, un éclat, dans le creux du sentier,
Il m’attendait, froissé — le temps retrouvé.




Là où le vent rejoint l’étoile,
Le ciel descend sans faire un vœu.
Le pas s’efface, l’âme s’envole,
Et le silence devient feu.
II. Retour – Le pas lent et joyeux
Je le reprends en main, je ris dans le soleil.
Tout est plus doux soudain, l’air m'émerveille.
Le monde a retrouvé ses lignes et son chant,
Et mon pas redevient le pas d’un revenant.
Je redescends léger, foulard au vent levé,
Comme un drapeau secret, comme un baiser noué.
Chaque arbre m’accueille, chaque pierre est amie,
Je suis ce qui revient, non plus ce qui s’enfuit.
Vers Puente la Reina, le chemin est moelleux,
Le ciel parle à mes pas dans un silence bleu.
Et je marche en dedans comme on marche en prière :
Le cœur lié au cou, la lumière à la pierre.
4. Puente la Reina-Gares
Puente la Reina est fille née du Camino vers l'an 1000 (2). Ce n'était qu'un simple gué sur les eaux tumultueuses de l'Arga que les pèlerins devaient traverser. Un pont roman de 110 m de long à six arches en plein cintre (la septième, la plus orientale, est enterrée) fut construit. Il fera sa célébrité et lui donnera son nom. Le pont était fortifié de trois tours, une à chaque extrémité et une autre au centre de celui-ci. À l'intérieur de la tour centrale du pont a été placée une sculpture de la Vierge de Puy, patronne de la ville.
Ce serait une souveraine, Doña Elvira, dite Doña Mayor (3), épouse de Sancho el Mayor (le grand - 981-roi 1000-1035) ou sa bru, Doa Estefania, épouse de Don Garcia de Nàjera (1021-roi 1035-1054) qui aurait faire construire ce pont. On trouvera mention de ce pont dans la chronique du pseudo Turpin, et Charlemagne y serait venu, "usque ad pontem Arge via Iacobitana" et " & ibi hospitatus est":


"Voici que Charles (Charlemagne), ayant combattu Aigoland (chef des Sarrasins) en raison de l’alliance avec la foi chrétienne, le tua ; c’est pourquoi il est manifeste que la loi chrétienne surpasse tous les rites et toutes les lois du monde. Remarque, ô chrétien : si tu gardes la foi solidement dans ton cœur et que tu l’accomplis par tes œuvres autant que tu peux, tu seras élevé, véritablement, au-dessus des anges, avec ton chef le Christ, dont tu es membre. Si tu veux t’élever, crois fermement, car « tout est possible à celui qui croit », dit le Seigneur. Alors Charles, après avoir rassemblé ses armées et s’être réjoui de ce grand triomphe, vint jusqu’au pont d’Arge, sur la voie de Saint-Jacques, et y reçut l’hospitalité." Justus Reuber in Veterum scriptorum, qui Caesarum & imperatorum germanicorum res per aliquot saecula gestas litteris mangdarunt tomus unus, 1726, p. 106.
Via Iacobitana.
Le chemin commence là où s’achève la guerre.
Le glaive a conduit jusqu’ici.
Désormais, c’est la coquille qui prend le relais.
En entrant dans la ville par ce qui reste de l'ancienne porte de Suso ou du Relox (4), je fus accueilli par la statue de Saint Jacques. "Aquí, los caminos se hacen uno." La via Tolosana (voie d'Arles), et le Chemin Navarrais, ou le Camino Francès venant de Saint Jean Pied de Port se rejoignent pour n'en faire qu'un.
La ville est dessinée rectangulairement autour de son axe central, la calle Mayor ou la Rúa Mayor, comme elle était appelée dans les textes du XIVe siècle. Perpendiculairement à la rue, se trouvent les bâtiments les plus majestueuses de la ville. Certains d'entre eux ont l'aspect palatial. Les maisons s’élèvent sur un socle de pierre, où dorment encore des portails d’arcs brisés ou ronds, sculptés au temps des chevaliers et des rois. Au-dessus, les briques baroques s’empilent en silence, portant des balcons de bois sculpté, comme des dentelles sombres suspendues au ciel. Et les façades parlent encore par la voix des blasons et des armoiries, souvenirs fiers gravés dans la lumière.
Une fois la calle Mayor remontée, s’ouvre le vieux pont — arc de pierre tendu vers l’horizon. C’est par là qu’on quitte la ville, et qu’un autre monde commence. L'ancienne tour centrale du pont n'est plus. Elle a été détruite en 1843 par les autorités du gouvernement libéral. Depuis cette date, l’église de San Pedro du XIVe contient la Vierge du Puy dite Vierge du Txori. D'après la légende, la statue recevait la visite d'un oiseau — "txori" en basque, qui remontait le fleuve, et cet oiseau nettoyait le visage de la Vierge avec de l'eau de l'Arga.
5. Le Txori
"Nehoiz enea ez da izanen maitatzen dudan izarra,
Hartaz oroituz, maiz etortzen zaut, begietara nigarra. (5)"
Sur le pont de la Reine, un ange au plumage modeste
Il venait seul, sans qu’on le voie,
Quand l’aube effleurait les toits.
Son aile trempée dans l’Arga
Montait caresser le doux front
D’une Vierge sculptée dans le bois.
Il vient dans l’heure où l’air s’ouvre, où la lumière se déplie comme un linge blanc sur la pierre. Il s’approche de la Vierge avec des gestes si simples qu’ils touchent l’éternel.
L’aile bat doucement. Elle chasse la poussière. Elle efface les fils gris des araignées. Le bec s’abaisse vers le fleuve, y puise une goutte vive, une hostie d’eau, et la remonte vers le front immobile de la Vierge. Il lave. Il recommence. Il consacre.
Nul besoin d’encens ni de chants. Ce qu’il accomplit contient toute la liturgie du monde. Il restaure le visage. Il redonne à la Mère ce qu’elle nous donne : la belle clarté, la réelle présence et la profonde tendresse.


Le village regarde. S'émerveille. Et, les cœurs s’ouvrent. Les cloches répondent. On célèbre ce mystère qui descend du ciel sur un oiseau, et du bec de l’oiseau sur le front de Marie. Une procession s’organise dans l’invisible. Une foule en liesse, mais l’oiseau, seul, est agenouillé.
Il revient chaque année. Les hommes vieillissent, les saisons passent, mais le Txori revient. Fidèle au saint visage. Fidèle au geste. Fidèle à Marie. Il porte en lui le silence de ceux qui aiment sans témoins.
Et quand la violence s’installe, quand le fer interrompt la louange, le Txori s’envole. Il quitte les pierres. Il emporte avec lui le secret. On ne le voit plus. Il disparait. Mais son geste demeure. Il a imprimé dans la mémoire du lieu une trace plus durable que la pierre : la mémoire d’un amour qui sert et se donne.
Et l’on devine encore, au matin, entre deux soupirs de brise, cette aile invisible qui revient. C'est l’œuvre qui continue. Car la grâce ne se retire pas. Elle se cache. Elle veille. Puis, elle recommence. Et encore ! Toujours.
Mais parfois, dit-on, dans l’église,
Un peu de vent glisse et déguise
Le silence d’une aile fine :
C’est le Txori qui s’incline.
Il aurait pu saisir l’oiseau dans un filet,
Lui tailler les deux ailes au nom de la tendresse,
Le garder pour toujours, muet, dans un reflet,
L’empêcher de partir au vent avec ivresse.
Mais l’oiseau sans l’élan oublie ce qu’il est,
Et l’amour qui retient défait ce qu’il promet.
Ce qu’on garde trop près finit par se briser,
Et le cœur se retire au lieu de s’embraser.
Moi, je l’aimais debout dans l’éclat du matin,
L’instant où l’on devine un adieu dans la grâce,
Prête à s’arracher même au creux de ma main —
Pour que l’amour demeure et garde sa place.
Sur le vieux pont, j’ai vu le roi s’arrêter,
Déposer son épée. Et se laisser aimer.
Et moi, pèlerin par amour silencieux,
Je passe sur ce pont, les yeux levés aux cieux.
Je dépose en mon cœur ce que j’aurais gardé,
Et j’aime, dans l’élan, ce qui doit s’envoler.
Je dépose le nom que je voulais nommer,
Je garde le secret brûlé sur ma poitrine.
Je défais doucement l’espoir de l’enfermer,
Je garde son regard, sa trace cristalline.
Je dépose l’envie de vous dire : « Revenez »,
Je garde en mon silence une paix singulière.
Je ne tends plus la main vers des chemins rêvés,
J’habite votre absence comme un sanctuaire.
Je dépose le poids de mes vœux trop serrés,
Je garde ce battement qui me rend plus fidèle.
Je m’éloigne, mais non pour l’avoir oubliée —
Je garde l’oiseau libre, et je marche avec elle.
Alors, dans un battement de pas, ou d'ailes, me revint
ce poème Txoria txori (6) :
"Hegoak ebaki banizkio
Neuria izango zen (bis)
Ez zuen aldegingo.
Bainan horrela
Ez zen gehiago xoria izango
Bainan horrela
Ez zen gehiago xoria izango
Eta nik, xoria nuen maite
Eta nik, xoria nuen maite."
Voici l'aurore, brille encore l'étoile
dans toute sa splendeur.
L'espoir soulève mon pas.
Eric Trélut, Gabat




Notes :
(1) "Moi, Maître Gonzalo de Berceo nommé, allant en pèlerinage, je tombai dans un pré vert et bien semé de fleurs, abondamment fleuri — lieu désirable pour tout homme fatigué." Voir Francesc Costa Oller, Villuga comentado : Repertorio de todos los caminos de España, 1546.
(2) La ville de Puente la Reina fut fondée en 1122 par le roi Alphonse I dit le Batailleur. Voir Lacarra, J.M., El desarrollo urbano de las ciudades de Navarra y Aragón en la Edad Media, 1950, Pirenaicos, p. 5-22.
(3) L. Marineo Sículo, De Genealogia Regum Aragonum, Saragosse, Georgius Cocus Alemanus,1509. "No vamos a insistir sobre el nombre de la reina que dio nombre al puente, si fue doña Mayor o doña Estefanía, porque el tema ya se ha debatido abundante y estérilmente. Lo que parece claro es que su construcción no debió terminarse hasta la segunda mitad del siglo XI. El argumento, negativo pero válido, es el silencio que la documentación guarda sobre él, mientras tenemos bastantes noticias de los lugares que lo rodean. Obanos, por ejemplo, y pequeñas aldeas como Villoria, Ecoyen, Sarría y Agós. Fue Sancho el Mayor el que abrió definitivamente el camino de Santiago, una vez alejado el peligro musulmán de su ruta. La Crónica Najerense recoge el hecho con estas palabras: "Et uiam publicam quam caminum Sancti Iacobi uocamus quamque peregrini timore maurorum per deuia Alaue euntes declinabant per locum quomodo itur sine retractationis obstaculo fecit currere". La muerte de Almanzor en 1002 puso fin a la amenaza y al terror que había pesado sobre los caminos de la peregrinación." On ne s’attardera pas sur le nom de la reine qui donna son nom au pont — fut-ce doña Mayor ou doña Estefanía — tant le débat fut déjà mené, avec abondance et stérilité. Ce qui semble acquis, c’est que la construction du pont ne dut s’achever qu’à la seconde moitié du XIe siècle. L’argument — négatif, certes, mais probant — réside dans le silence des archives à son sujet, alors que les villages alentour, eux, apparaissent clairement dans les documents : Obanos, par exemple, ou encore les petites localités de Villoria, Ecoyen, Sarría et Agós. C’est Sanche le Grand (Sancho el Mayor) qui ouvrit de manière décisive le chemin de Saint-Jacques, une fois le danger musulman éloigné. La Chronique de Nájera relate l’événement en ces mots : “ Et il fit passer par ce lieu la voie publique que nous appelons le chemin de saint Jacques, que les pèlerins, par crainte des Maures, évitaient en empruntant les détours d’Álava, et il la rendit praticable sans obstacle ni détour.” La mort d’Almanzor en l’an 1002 mit un terme à la menace et au climat de terreur qui pesaient sur les routes du pèlerinage. Uranga, José Javier, "Puente la Reina, del Puente al Fuero (1085-1122)" (1984) Scripta theologica. revista de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra Vol. 16 Núm. 1 Pág. 473-484.
(4) La porte de Suso ou du Relox (Portal de Suso o de Relox) recevait les pèlerins et était située sous une tour qui a été détruite en 1800 et qui avait une horloge. D'où son nom : Porte de l'horloge.
(5) Xalbador, (Fernando Aire, 1920-1976), Odolaren mintzoa, Tolosa, Auspoa, 1976, p. 114.
"Jamais ne sera mienne l'étoile que j'aime,
En me souvenant d'elle souvent mes yeux se remplissent de larmes."
(6) Txoria Txori, plus connu sous le nom de « Hegoak » est un poème écrit par le poète Joxean Artze (1939-2018). Véritable ode à la liberté et à l’amour, le poème est chanté pour la première fois à la fin des années soixante par Mikel Laboa (1934-2008).
"Si je lui avais coupé les ailes
Il aurait été à moi
Il ne serait pas parti
Oui mais voilà,
Il n’aurait plus été un oiseau
Oui mais moi,
C’était l’oiseau que j’aimais."