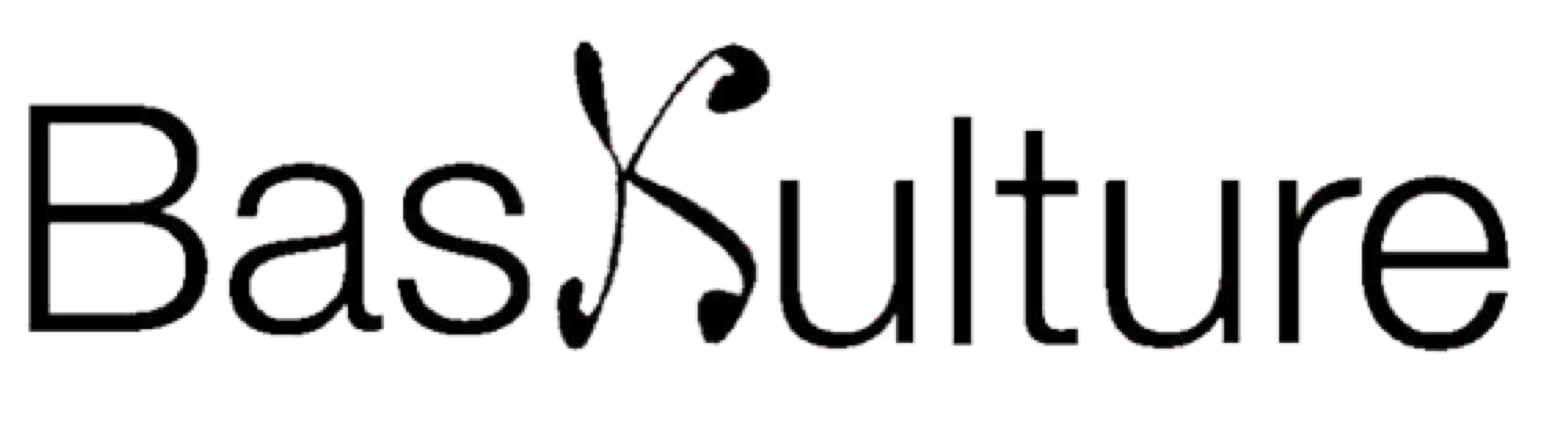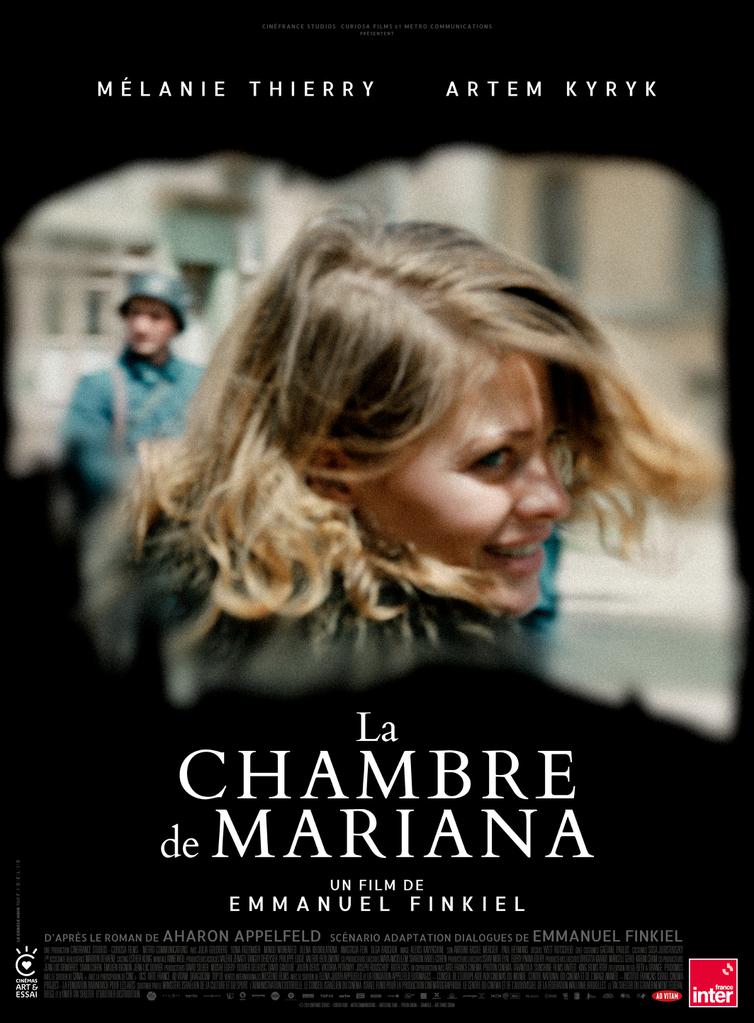Le 22 juin 1941 à l’aube, l’armée du IIIème Reich, La Wehrmacht, renforcée par six pays satellites de l’Axe, attaque l’Union Soviétique sans déclaration de guerre au préalable. Près de quatre millions de soldats s’élancent à partir de la Pologne, partagée en deux, conséquence du Pacte germano-soviétique (août 1939). C’est l’opération Barbarossa. Staline bien qu’informé à de nombreuses reprises de l’invasion imminente (concentration des troupes !) n’y croit guère. Très rapidement sous les coups de boutoir des envahisseurs, le front soviétique s’écroule : les armées allemandes arrivent en décembre 1941 aux portes de Moscou. (Durant Les Grandes Purges de 1936 à 1938, Staline et ses sbires, ont fait tuer 80% des officiers supérieurs de l’armée Rouge !).
Czernowitz, ville d’Ukraine en Galicie orientale, est connue pour sa dimension culturelle, cultuelle et sioniste (environ 2,5 millions de juifs étaient présents en Ukraine en 1939). Ces juifs, intégrés dans la société, étaient forts nombreux avant l’arrivée des allemands dès l’été 1941. Les juifs Ashkénazes, raflés avec l’aide « d’auxiliaires ukrainiens », sont assassinés en masse par les Einsatzgruppen (unités mobiles d’extermination) et la Wehrmacht : c’est la « Shoah par balles » (expression forgée en 2006 pour désigner la Shoah en Ukraine).
Czernowitz, 1942. La nuit, une femme juive (Julia Goldberg) passe par les égouts en compagnie de Hugo (Artem Kyryk), son fils âgé de 12 ans. Elle le confie à sa meilleure amie, Mariana (Mélanie Thierry), en demandant à Hugo de se cacher et de garder une confiance absolue en elle. Mariana est une prostituée qui vit dans une maison close accueillant des soldats allemands. Dans ce bordel, elle possède sa chambre où elle reçoit ses clients habituels ou de passage. Afin de dissimuler Hugo, elle l’enferme dans un placard ; elle lui apporte de la nourriture et lui intime l’ordre de ne faire aucun bruit. Personne ne doit connaitre son existence dans cette bâtisse sonore ou tous les bruits se propagent.
Hugo, abasourdi par sa condition vit dans un premier temps prostré dans sa cache où des souvenirs du passé immédiat, l’assaillent. Le temps passant, il s’enhardit car Mariana, grande buveuse d’alcool, à la personnalité fantasque, le laisse évoluer dans sa chambre. Mariana soumise à des contraintes de prostituées (elle ne peut refuser un client) finit par s’attacher à ce garçon intelligent, elle si peu instruite. Elle le protège malgré le danger permanent …
Avec La Chambre de Mariana, le réalisateur et scénariste Emmanuel Finkel (63 ans) clôt sa trilogie de la Shoah : Voyages (1999), trois femmes confrontées au souvenir des survivants de la Shoah et La Douleur (2017) d’après le récit « autobiographique » de Marguerite Duras (1914/1996) ont précédé son dernier opus. Il poursuit son œuvre en hommage à ses grands-parents paternels, raflés en 1942, à Paris, lors de la rafle du Vel-d’hiv (juillet 1942) puis déportés et assassinés à Auschwitz-Birkenau. Emmanuel Finkel a adapté le roman éponyme (La Chambre de Mariana – Éditeur L’Olivier – 2008) de l’écrivain israélien Aharon Appelfeld (1932/2018) qui a vécu dans son enfance des situations similaires à son roman (après son évasion à l’automne 1942, il se cache dans les forêts d’Ukraine pendant trois ans en compagnie de marginaux avant d’être recueilli par des paysans auxquels il cache qu’il est juif).
Dans son abri, dans un premier temps, Hugo vit dans un environnement sensoriel (images et sons) qu’il perçoit à travers de minces cloisons qui l’isolent, physiquement, du réel. Le vécu ambiant, potentiellement dangereux, est perçu à travers des interstices, des trous, qui lui permettent d’apercevoir des fragments du réel de la chambre et de l’extérieur, tous deux chargés de menaces. Dans ses longs moments d’inaction, de silences imposés, de brefs flashs mythifiés (?) du passé surgissent : son « Roman Familial ». Sont-ils vécus ou inventés ?
Emmanuel Finkel maitrise ce récit à plusieurs niveaux de lecture, celui d’un « enfant du placard » s’éveillant à la vie dans la douleur et avec ses pulsions (positives ou négatives). Le réalisateur déclare à ce sujet : « Mariana, c’est Eros, pas seulement au sens sexuel, mais au sens plus global de la vie. Thanatos, c’est le repli, le pas bouger, le pas penser, le pas stimuler, tourner le dos à la vie. Eros, au contraire, c’est forcement voir demain. C’est ce qui m’a motivé à faire ce film ». Avec son directeur de photographie Alexis Kavyrchine, Emmanuel Finkel a choisi de tourner ce drame en format « carré » (1.37:1) dans lequel insère les comédiens dans un cadre étroit, rectangulaire, et de ce fait « emprisonne » les personnages, densifie les émotions d’autant que la palette chromatique oppose l’intérieur (couleur chaudes, maternantes) à l’extérieur (couleur froides hostiles). D’autre part, saluons la variation des axes de prises de vues choisis dans un espace clos (placard, chambre), jamais redondante. C’était un challenge !
Les deux acteurs principaux, Mélanie Thierry (Mariana) et Artem Kyryk (Hugo), parlent ukrainien la première française a appris la langue (durant deux ans !) ; le second un enfant est ukrainien. Son jeu est tout en nuance face à la comédienne professionnelle. A cet égard, la direction d’acteur que l’on devine pointilleuse, nous offre une large palette d’émotions d’autant que Emmanuel Finkel évite, en bon scénariste les répétitions de situations : le récit progresse lentement (2h 11 minutes) sans jamais nous lasser. Prouesse d’un grand artiste.
La Chambre de Mariana, tragédie de la Seconde Guerre Mondiale comme il y en eut tant d’autres, n’en reste pas moins un long métrage lumineux, éclairé par la figure complexe de Mariana, une prostituée. Une Juste.