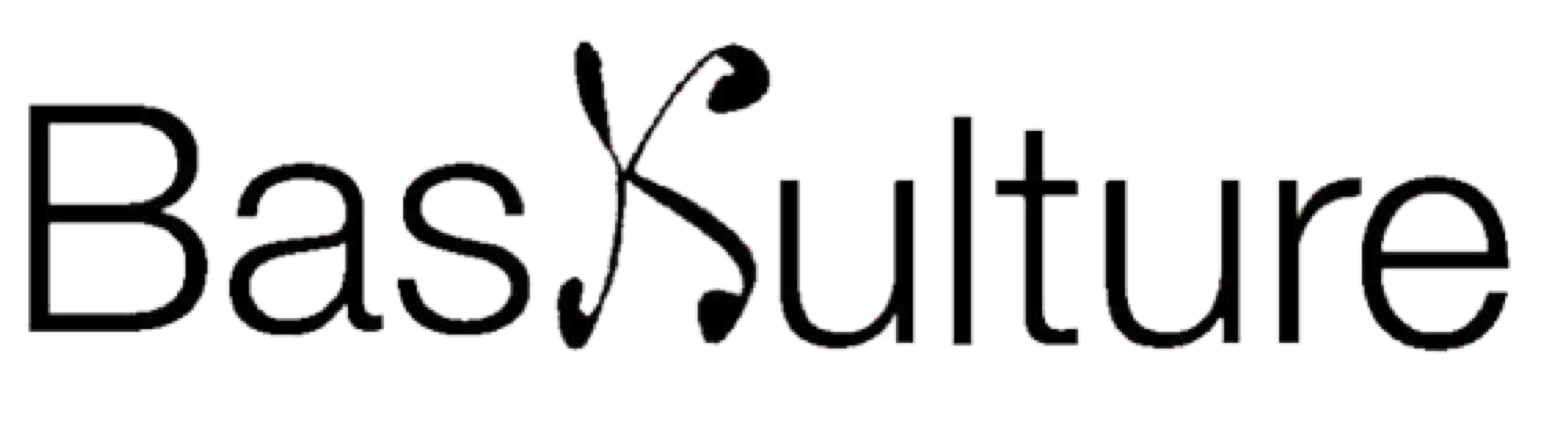« Il partit sans savoir où il allait. » (Hébreux 11,8)
I. Grave : « Nel mezzo del cammin »
Il faut gravir lentement ; le pas de l’âne connaît mieux la montagne
que l’éperon du cavalier.
Nous sommes tous à la moitié de notre vie (1). Et, au milieu du chemin de notre vie, nous nous retrouvons par une « forêt obscure » (Dante, Enfer, I, 1-2) — une forêt dense d’ombres, d’incertitudes, de silence. Une forêt où, soudain, le réel devient énigmatique. Ne croyez-vous pas, vous aussi, entendre résonner en vous cette parole inquiète ?
Il nous faudra quitter ces frondaisons épaisses, car le sentier nous conduit plus loin encore — vers un seuil, un passage, une porte gravée de feu. Cette porte, Dante l’aperçut au terme de la forêt, dressée comme un avertissement à ceux qui persistent à avancer :
« Vous qui entrez, laissez toute espérance » (Enfer, III, 9).
Oui, la voie du paradis commence souvent par un abîme, et ce qu’il faut traverser d’abord, c’est l’Enfer. Ces mots, teintés d’une sombre couleur, inscrits au sommet de la porte, sont durs (Enfer, III, 10-12) ; qui peut les écouter ?
Mais ce chemin abrupt — n’est-ce pas le nôtre ? Ce sentier escarpé qui ne mène pas simplement vers un sommet, mais d’abord vers une nuit, consentie. Car pour gravir la montagne lumineuse, il faut traverser l’obscur de soi. Il faut accueillir le paradoxe, terrible et beau, d’un dépouillement nécessaire.
C’est dans cette nuit du sens, dans cette obscurité offerte, que commence à luire la véritable sagesse — celle qui n’éblouit pas, mais éclaire doucement, de l’intérieur. Celle qui nous apprend à contempler humblement les étoiles… depuis le cœur même de notre nuit.
Cette « parole dure » est celle du mystère. Elle fut prononcée à propos du Pain de Vie, ce corps offert, cette chair à manger, ce sang à boire. Dans l’un et l’autre cas, il ne faudrait pas reculer ou se retourner, mais franchir la porte. Il faut franchir la porte. Deux abîmes : celui de la porte de l’enfer de Dante, et celui de la parole eucharistique qui scandalise dans l’Évangile de Jean. Deux portes, deux mystères, deux « paroles dures » … et peut-être, au fond, un même appel à dépasser ce qui nous rassure pour entrer, nu de soi-même, dans l’invisible qui sauve. Le seuil obscur prépare à une descente. Marcher, c’est toujours aussi descendre. Une façon d’être fidèle à la parole dure, de s’ouvrir au mystère qui nous appel.
Et si le « dur » n’était que notre cuir qui craque devant le feu de l’Amour ? La porte de l’Enfer déclare la fin de l’espérance humaine. La porte eucharistique annonce un salut par ce qui nous paraît impossible : manger Dieu. Mais dans les deux cas, c’est notre monde intérieur qui est mis à nu : ce que je refuse, ce n’est pas tant l’obscurité du mystère, mais de ne plus me contrôler. Elle me laissa d’abord interdit, comme les disciples qui s’éloignèrent. Comment croire à un amour qui se fait nourriture ? Il y a des paroles qui ne s’ouvrent que par le pas. Des mots que l’on ne comprend qu’en les traversant avec tout son corps, comme une mer intérieure qu’il faut fendre.
Ces deux paroles, en moi, ont résonné comme des coups de tonnerre, et se répondent dans mon cœur. Elles brisent toutes mes certitudes, marquent l’entrée d’un chemin. Toutes deux me parlent d’un passage. Toutes deux me placent devant un mystère : non celui du désespoir, mais celui du réel absolu, qui déchire les voiles du confort.
Le chemin vers Compostelle est lui-même un seuil. Il commence non pas à la porte d’une cathédrale, mais là où la parole devient insupportable sans amour. Cet amour qui accueille l’âme blessée par le sens dur. Non ! Il ne faut pas fuir la parole difficile, ce serait se fuir soi-même, mais la porter, pas à pas, sur mes épaules d’homme. En marchant, la parole qui brise est aussi celle qui ouvre. Comme le seuil du tombeau roulé à l’aube. Il ne se termine pas à Compostelle. Marcher vers Compostelle, c’est marcher tout doucement vers une fontaine que seul l’amour peut faire découvrir.
Je suis donc parti. Parti pour écouter ce que je ne comprends pas. Parti avec une parole de feu sur les lèvres, un silence de pierre dans les mains, et un Nom dans le cœur.
Le chemin est une passion. Ma passion. C'est là le commencement du terrible ! Marcher, c’est d'abord perdre pied ; aimer aussi, sans doute, et vivre, tout simplement. Incipit vita nova (2). Un jour, un chant. Le jour où j’ai commencé à marcher fut le début de ma vie nouvelle, de cette vie qui, à chaque aube, recommence encore. Ainsi, chaque pas esquissé est une naissance offerte à l'inconnu, une renaissance humblement consentie au mystère qui nous précède toujours.
II. Andante : Veiller le feu
Le Morvan est une île de granit : l’hiver y forge plus qu’il n’endort,
et le marcheur qui s’y risque apprend la lenteur qui sauve.
Le Morvan est un désert vert. Et parfois, le désert se révèle plus rude que la pierre. Ce jour-là, il ne m’a pas accueilli ; il semblait même se retirer. Il pleuvait depuis des jours, les chemins étaient lourds, détrempés, et les arbres menaçaient de céder sous la violence du vent. J’avais froid. J’avais soif. Pourtant tout ruisselait autour de moi. Étrange découverte : le corps peut avoir soif alors même que l’univers entier semble saturé d’eau. Mais la pluie ne désaltère pas. Le froid, lui, dessèche en silence, sournoisement. Des crampes m’ont surpris. Je ne comprenais pas ; je n’avais pas faim, simplement j’étais vidé.
J’ai trouvé refuge, deux jours durant, dans une cabane perdue auprès d’une femme hollandaise et de ses deux chiens. Elle dormait avec eux, moi je dormais seul. Elle était là, mais ailleurs ; moi aussi, sans doute. Au centre, un poêle à bois qu’il fallait entretenir avec délicatesse. Ce fut ma tâche, humble et silencieuse : veiller sur le feu. La nuit, sous les rafales de pluie et les craquements sinistres des arbres, il devait tenir. Ce feu-là n’était pas seulement utile, il était devenu un compagnon discret, une pulsation dans l’obscurité, une manière d’être présent au monde.
Puis j’ai repris la route. La solitude était dense, compacte, presque palpable. Le ciel bas pesait sur moi, le soir approchait lentement. Pas d’eau, pas de source. J’avais froid aux mains, froid aux pensées. En arrivant à Onlay, petit village blotti dans le silence, c’est une statue de la Vierge qui m’a accueilli. Je me souviens de son regard, sans regard, présence muette mais réelle, chargée d’une tendresse invisible. J’ai frappé à une fenêtre éclairée ; une main m’a tendu une bouteille d’eau, geste discret, presque furtif, mais à cet instant, don immense.


C’est alors que le maire est apparu, Daniel Martin. Il ne m’a rien demandé, il m’a reconnu.
Non pas moi, mais ce que je portais avec moi : la fatigue, la soif, la nécessité absolue d’un abri. La coquille ! Il m’a ouvert la Mairie, ancienne école communale. À l’intérieur, une lumière douce, un lit à l’étage, un grand lavabo blanc, un frigo. Et ces mots essentiels : « Prenez ce dont vous avez besoin. Reposez-vous. »
Plus tard, il est revenu. Dans ses mains, un pain encore chaud, deux tartes aux pommes préparées par son épouse, et du chocolat pour le dessert. Je n’ai pas pleuré, mais quelque chose en moi s’est dénoué, s’est offert doucement à ce qui venait.
Ce n’était plus seulement de la nourriture : c’était une bonté incarnée, un soin donné sans bruit, une chaleur transmise par ce pain encore vivant.
La nuit a lentement enveloppé l’ancienne salle de classe. Je me suis lavé, j’ai mangé, j’ai dormi. Et dans ce silence profond du Morvan, où la pluie frappait encore doucement aux fenêtres, j’ai ressenti une paix simple, infinie, profonde—douce comme une tarte aux pommes partagée dans l’obscurité.
III. Allegretto : Lettres dans la pluie
« J’admire cette lente préparation du beau temps. » Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, ch. VII
Le lendemain matin, entre deux crampes et une forêt toujours silencieuse, j’ai trouvé deux lettres glissées dans la doublure de mon sac. Je ne les y avais pas mises. Elles n’étaient signées que d’un trait d’étoile, du Petit Prince. Les contes de fées sont donc vrais !
Je les ai lues sous la pluie, entre deux gorgées de silence. Dans le Morvan, les forêts parlent par les arbres, mais parfois aussi par les lettres.
Il suffit de marcher assez longtemps, de se taire assez profondément, pour que l’on commence à recevoir. Pas des réponses. Mais des voix. Elles viennent d’enfance, d’étoiles, de fleurs. Elles disent des choses simples. Et essentielles. C’est ainsi qu’ont commencé ces lettres.
Première lettre du Petit Prince au marcheur du pas de l’âne


« À vous, marcheur au cœur ouvert, je vous écris depuis une étoile discrète, voisine de la tienne. Je vous ai vu, vous savez. Je vous ai longuement regardé. Vous marchiez, penché et fourbu, les épaules ployées sous un silence trop lourd et les chaussures usées par des questions restées sans réponse.
Certes, quand vous priiez votre chapelet, vous ne leviez plus les yeux vers le ciel, mais vous contempliez la poussière. Et pourtant, chaque grain de cette poussière devenait lumière sous vos pas, car vous marchiez au pas de l’âne - ce pas humble et fidèle que les hommes pressés ne connaissent plus, mais que les étoiles reconnaissent immédiatement.
Moi aussi, j’ai cherché l’eau. Mais ce n’était pas de l’eau pour mon corps. C’était une eau pour ma rose, une eau pour mon cœur, une eau capable de faire vivre qui l’on aime. Et vous savez quoi ? Je l’ai trouvée, un soir, dans le désert. Elle ne jaillissait pas du sol, non ; elle venait du silence lumineux entre deux âmes.
Ce que j’ai appris, marcheur, c’est que l’eau ne se cherche pas comme un trésor caché sur une carte. Elle se laisse trouver par ceux qui deviennent source pour les autres. Vous, qui avancez lentement, pas après pas, ne croyez jamais que vous allez trop lentement. Vous êtes simplement en train de creuser l’espace intérieur où un jour, soudainement, une voix murmura :
« Donnez-moi à boire. »
Et alors vous répondrez :
« Si longtemps j’ai marché pour enfin devenir la source qui vous reconnaît. »
Je vous embrasse depuis le bout discret de ma comète, et je dépose doucement cette phrase au bord de votre chemin :
« On ne voit bien qu’avec le cœur—cela, vous le savez déjà. Le pas de l’âne est le rythme secret du cœur. »
À bientôt, mon ami,
Votre Petit Prince »
Deuxième lettre du Petit Prince au marcheur du pas de l’âne


« Mon cher marcheur,
Je vous ai revu ce matin, très tôt, alors que le ciel n’avait pas encore dissipé toutes ses ombres nocturnes. Vous étiez là, immobile au bord d’un champ ruisselant. Vous regardiez une herbe fragile trembler doucement dans le vent, comme si elle seule détenait un secret que vous aviez oublié. Alors, j’ai compris : vous apprenez. Vous apprenez que l’important n’est pas d’arriver, mais de devenir léger. Pas léger comme une plume, non, mais léger comme un fruit mûr, qui un jour se détache sans bruit de la branche qui l’a porté.
Le pas de l’âne vous a mené jusque-là, vers cette lente sagesse qui ne fait aucun bruit, vers cette paix réservée à ceux qui ne cherchent plus rien d’autre qu’aimer. Vous souvenez-vous ?
Un jour, j’ai rencontré sur la Terre un aiguilleur de trains. Il m’avait confié que les hommes ne savent plus ce qu’ils cherchent, alors ils courent, ils tournent en rond. Mais vous, marcheur aux étoiles, vous ne tournez pas en rond. Vous allez tout droit, vous allez loin, sans savoir exactement où, mais avec une confiance infinie.
Et c’est cela, précisément, qui fait de vous un poème silencieux.
Je voulais vous envoyer un conseil, mais il n’y en a qu’un seul, au fond : continuez de marcher comme vous écoutez, continuez d’écouter comme vous marchez. Car un jour, vous le savez, quelqu’un aura soif de cette eau que vous aurez trouvée au plus profond de vous.
Ce soir, je vous écris depuis ma planète. Je suis assis sur un volcan endormi, et je pense à vous comme on pense à une rose : avec attention, avec soin et tendresse.
N’oubliez jamais :
« Ce que vous cherchez vous attend dans le pas même que vous posé. »
Et si jamais vous doutez... alors levez les yeux. Je serai là-haut, quelque part, à cligner doucement, comme une étoile un peu fatiguée mais toujours fidèle.
À demain, peut-être,
Votre Petit Prince »
Il suffit d’ouvrir les yeux pour voir, et la vision s’accomplit d’un seul trait. La lumière entre comme une flèche dans la chambre obscure, elle transperce toute immobilité, elle est pure grâce. Mais marcher, pas à pas, au pas de l’âne, ce n’est pas recevoir la lumière d’un seul coup. C’est la chercher à tâtons, dans les ombres du quotidien, dans les frottements rugueux des pierres et les silences habités, dans la lenteur même du corps qui proteste doucement.
Marcher au pas de l’âne, c’est croire que le but existe, même quand on ne le sent plus. C’est avancer sans preuve, porté par l’espérance. C’est ne pas hâter la grâce, mais l’accueillir patiemment. C’est apprendre la patience par les muscles fatigués, l’humilité par les ampoules aux pieds, la sagesse par la poussière recueillie à chaque pas. Ainsi, marcher, lentement, au pas de l’âne, pour que l’amour puisse mûrir et le cœur s’accomplir pleinement.
Le monde moderne veut voir immédiatement. Il affirme : « Je crois ce que je vois ». Mais le pèlerin, lui, répond doucement : « Je vois ce que j’espère. » Le pas de l’âne est lent, mais fidèle. Il épouse secrètement la cadence de l’Évangile. Car le premier pas n’est pas fait pour avancer, il est fait pour s’abandonner. Et le second pas aussi.
Oui, s’il suffit d’ouvrir les yeux pour que la vision s’accomplisse, marcher pas à pas, au pas de l’âne, c’est laisser la marche elle-même devenir le but. C’est permettre au pas lui-même de s’accomplir, comme une humble eucharistie de poussière.
Il y avait eu le froid. La pluie. Les arbres menaçants. Le poêle à bois qu’il fallait nourrir comme un feu sacré. Puis les crampes, la fatigue, la soif dans un monde saturé d’eau. Les lettres qui consolent du Petit Prince. Et soudain, une lumière. Non pas dans le ciel, mais en moi. Une douceur inattendue, presque infime, comme une caresse sur une main calleuse. Quelque chose en moi s’est mis à fleurir, sans bruit. Sans pourquoi. Je venais de comprendre alors que ce chemin, dans sa lenteur rude, dans ses silences boueux, préparait une fragilité. Une ouverture. Un lieu pour accueillir la beauté quand elle viendrait. Non pas la beauté la plus éclatante, mais la beauté cachée, silencieuse, exigeante : la beauté … d’une Rose.
Et elle est venue. Pas d’abord en personne. Mais par une lettre. Une lettre que je n’avais pas cherchée : je l’ai trouvée un jour, comme on surprend une lueur nichée au creux d’une larme. Elle s’est adressée à moi comme on s’adresse à un silence. Et, c’est peut-être pour cela que je l’ai entendue : parce que, sans le vouloir, j’étais devenu assez silencieux pour l’écouter.
La voici :
Lettre de la Rose au marcheur silencieux
(Première et dernière lettre, après les deux du Petit Prince)
« À vous, marcheur que je n’ai jamais vu, mais que je devine dans la lumière que le Petit Prince m’a confiée de vous. Il m’a tout dit. Votre fatigue précieuse. Votre pas patient. Votre sac toujours trop lourd et votre cœur trop vaste. Il m’a dit votre manière d’écouter les pierres, de parler aux silences, de votre désir d’aimer simplement.
Vous marchez, m’a-t-il dit, au pas de l’âne — ce pas humble que les étoiles connaissent, et que les fleurs, comme moi, n’oublient jamais. J’ai longtemps cru qu’aimer, c’était attendre. Mais, en vérité, aimer, c’est marcher vers qui l’on aime, sans hâter, et le laisser venir à soi. C’est devenir, lentement, le lieu où l’autre pourra s’asseoir. Comme une clairière dans la poussière.
Je ne suis pas une destination. Je suis un secret. Et les secrets n’apparaissent qu’à ceux qui marchent sans bruit, sans cartes, sans vouloir tout comprendre.
Vous ne me connaissez pas encore. Et pourtant, vous me portez déjà. Je suis cette tendresse que vous laissez dans vos pas. Ce frémissement qui vous prend quand vous ne savez plus si vous avancez ou si vous priez. Je suis la réponse que vous ne cherches plus. Je suis cette parole que vous n’avez pas encore prononcée. Cette paix que vous ressentez parfois dans le creux de vos paumes ouvertes. Cette beauté que vous ne comprenez pas encore, mais qui pourtant vibre en vous.
Alors marchez, marcheur. Continuez. Ne vous hâtez pas. Les roses n’aiment ni la précipitation, ni les gestes brusques. Et la lumière la plus douce se révèle souvent au tout dernier tournant du chemin. Le vent me rapporte parfois un peu de votre fatigue. Et dans ce souffle-là, je commence à m’ouvrir.
Je ne vous écrirai pas souvent. Mais chaque fois que votre respiration ralentira, chaque fois que vous déposerez votre sac, chaque fois que vous écouterez le vent murmurer à votre cœur, je serai là —
Au creux même de votre silence.
Avec tendresse, La Rose »
Je marche. Je marche parce que quelque chose en moi s’est éveillé. Une soif que rien ne peut nommer. Un appel qui ne vient pas du dehors. Quelque chose de doux et d’urgent, de nu et de vaste. Je marche au pas de l’âne, ce pas humble, têtu, désaccordé, mais vrai.
Je veux devenir lieu.
Lieu où l’eau puisse sourdre en silence.
Lieu où une rose puisse fleurir sans trembler, à l’abri du bruit, à l’abri du vent.
Je marche…
Je marche, et peu à peu je deviens traversé. Je ne sais plus vraiment qui je suis. Mais je suis là. Et cela, doucement, suffit. Puis un jour, j’ai vu, dans les yeux d’un enfant tombé d’une étoile, le reflet de ma propre soif. Il m’a dit, avec la douceur de l’évidence :
« Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque part… »
Et alors, j’ai su. J’ai su que j’étais moi-même ce désert, et que le puits que je cherchais depuis toujours demeurait au fond de moi. Ma marche, dès lors, n’était plus un chemin vers Compostelle.
Elle devint un chemin en moi.
Pourtant, je marche.
Je marche jusqu’à quarante mille pas par jour, et chacun de ces pas est devenu pour moi un effort semblable à une prière de tremblement — une liturgie lente et fragile. Et si un jour, au détour d’un sentier, je trouve ma rose, je saurai m’asseoir près d’elle sans vouloir la cueillir. Je saurai simplement être là, présent comme une goutte d’eau attendue, silencieuse et essentielle.
Elle aura toute mon audience, toute la tendresse patiente de mon écoute.
Je suis celui qui marche. Et dans ce pas lent, ce pas habité de silence, je suis devenu un peu plus vrai, un peu plus vide peut-être… ou bien —
Un peu plus rempli de vous, vous qui m’espériez, vous pourtant si inattendue.
[…] la nature approuve
Ce couple, âne marchant, philosophe portant (3).
Eric Trélut,
Gabat


Notes :
(1) Dante, Divine Comédie, Enfer, I : « Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita. » Étant à mi-chemin de notre vie, je me trouvai dans une forêt obscure, la route droite ayant été gauchie.
(2) Incipit vita nova — « Ici commence une vie nouvelle » — est la formule latine qui ouvre le manuscrit autographe de La Vita Nuova de Dante Alighieri (v. 1292‑1294). Elle sert d’incipit à l’œuvre : Dante y raconte, en prose et en vers, la naissance d’une existence transformée par la rencontre de Béatrice.
(3) Victor Hugo dans un long poème paru en 1880, L’Âne : « […] la nature approuve Ce couple, âne parlant, philosophe écoutant ».