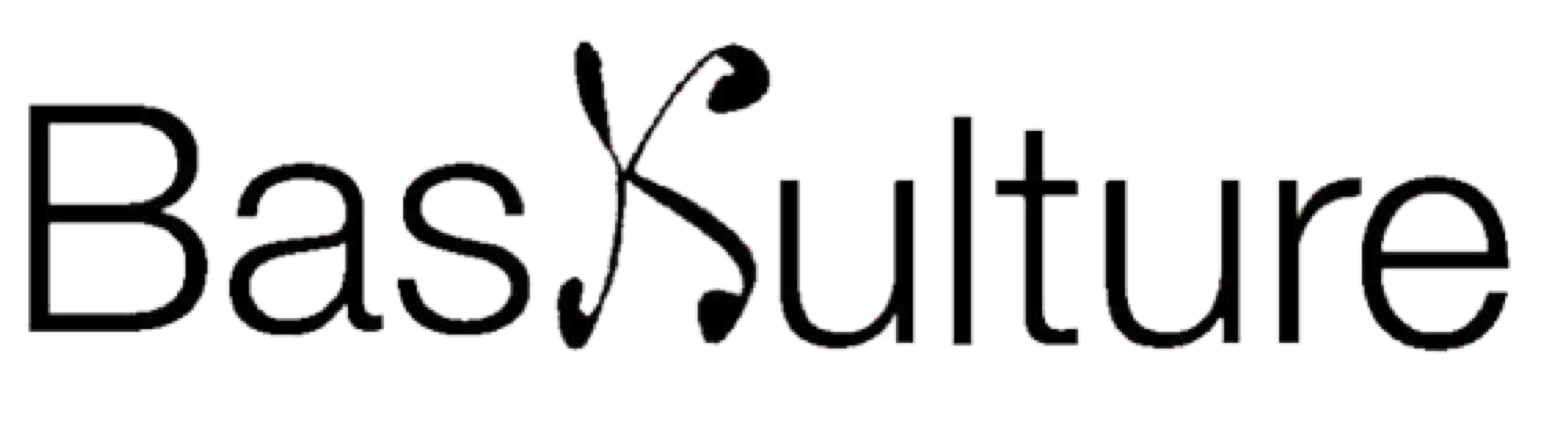La 6ème édition du Festival Musical et Littéraire d’Arnaga a fait le plein, depuis le concert « Aria Pirenèus » à l’Église Saint-Laurent, voyage musical sur les Chemins de Compostelle créé par l'auteur-compositeur et ténor Michel Fenasse-Amat avec Xabi Cuende, direction musicale, Ramuntxo Luberriaga, ténor, le chœur Lagunak Abesbatza, Laura Bide, accordéon, Ekain Cachenaut, txistu et txirula & Mandolines, mandoles et guitares de l’Estudiantina de Ciboure, laquelle s'est également produite avec succès devant l'Orangerie, en fin de festival, jusqu'à la conférence "Les Pyrénées, de l’Impératrice Eugénie à Edmond Rostand", promenade musicale, historique et littéraire conçue par Alexandre de La Cerda avec la participation des chanteurs et comédiens de la manifestation.
Le public qui remplissait le grand salon de la Villa Arnaga a particulièrement apprécié le ténor Ramuntxo Luberriaga ainsi que la master-class de chant choral du festival qui avait entonné avec beaucoup d'entrain la célèbre chanson "Pottoka Mendian" ainsi que des airs pyrénéens célèbres.
Tout au long de l’histoire, la barrière naturelle du massif des Pyrénées était un mur redoutable pour ceux qui voulaient la franchir, et pour tous les assaillants des deux versants. Du temps des Romains, jusqu’à des époques plus récentes, traverser les montagnes pyrénéennes à pied ou à cheval semblait un défi humain propice à toutes les aventures. Citant les chroniques du temps passé, Alexandre de La Cerda entreprit une histoire des Pyrénées en soulignant que les couloirs naturels, tel le Pas-de-Roland au Pays Basque ou le Somport en Béarn, étaient empruntés « avec crainte et tremblement » par les militaires avec leur matériel, car l’ennemi réel ou fictif pouvait se loger dans les cavités et les crevasses des montagnes, et faire irruption et détruire tous les assaillants de cette majestueuse barrière naturelle, réputée imprenable et défensive.
Au Moyen Age, l’administration des territoires des deux côtés du Massif Pyrénéen occupera les princes castillans, aragonais, navarrais, anglais et français, et fera surgir diverses petites principautés et républiques, au nombre desquelles la vallée de Baztan, Cinco-Villas avec Aranaz, Yanci, Lesaca, Echalar et Vera de Bidasoa, en correspondance avec notre « Sarako errepublika », et l’existence dans nos montagnes des antiques faceries ou paceries (paix), ces traités diplomatiques avant la lettre qui constituent une particularité des provinces basques : conclues et renouvelées entre les communautés des vallées transfrontalières (en dehors de Madrid et de Versailles ou Paris), elles assurent encore le pacage des troupeaux sur les versants les mieux exposés à l’ensoleillement.
Dernière en date, la « Marque d’Urepel » conclue en 1858 entre Garazi (vient de Caesaris, ou vallée de Cize/StJean Pied de Port), et Roncal et Aezkoa, en Navarre : les troupeaux de vaches blondes des Pyrénées de la vallée de Baigorri prennent ainsi leurs quartiers d'été sur ce plateau situé à 1 000 mètres, en Pays Quint. Ce bétail peut aller paître, moyennant une redevance par tête, dans la vallée d'Erro dont le garde appose au fer rouge les initiales « VE » (Valle de Erro).
Et le Pays Quint, au-delà des Aldudes (avec leur bon jambon Kintoa grâce à l’ami Pierre Oteiza) qui est un vestige de l’ancien royaume de Navarre, une enclave basque neutre entre la France et l’Espagne qui forme un territoire indivis réglementé par une juridiction de conventions pastorales de bon voisinage, d'abord orales puis écrites, pour être transformées en traités internationaux...
L'orateur fit une petite parenthèse sur ces spécificités basques et pyrénéennes, sur mer également, les « traités de bonne correspondance » préservaient la paix, les échanges commerciaux et les communications maritimes par cabotage jusqu'à quatre lieux de la côte entre Guipuzcoans et Biscayens d'une part, Labourdins de l'autre, quand les souverains respectifs (anglais, français ou castillan) se faisaient la guerre.
Et pour revenir aux montagnes Pyrénées, la toujours indépendante principauté d’Andorre, dont Gaston Febus - l'ancêtre du conférencier - fut le co-prince et assura également l’indépendance de la vicomté de Béarn par rapport à ses suzerains et puissants voisins aragonais, anglais et français !
En 1347, il proclama l’indépendance du Béarn et pendant la Guerre de Cent Ans, son habilité préservera le Béarn de la guerre alors qu’il est à la tête d’une redoutable armée qui permettra à l’État indépendant du Béarn de faire face aux couronnes de France et d’Angleterre (à Pau, il existe une « rue du Béarn indépendant).
Précisément, féru de chasse et de chiens, n’avait-il pas adopté parmi ses rendez-vous de chasse la petite localité d’Aigue boune – Les Eaux-Bonnes, en français – mais il faudra attendre le XVIème siècle pour y voir construire un premier bâtiment de quelque importance : il s’agissait d’un hôpital militaire, construit par François Ier et destiné aux Béarnais blessés à la bataille de Pavie (1525) par de nouvelles armes : les arquebuses ! D’où la première dénomination de ces eaux sulfureuses aux vertus cicatrisantes qui y surgissaient en fait depuis des millions d’années : c’était les « Eaux d'Arquebusades ».
Les médecins recommandaient et prescrivaient de boire le plus possible. Ils suggéraient d’alterner entre des eaux froides et chaudes, sachant qu’à la source, l’eau sort à 40 degrés.
L’époque où Marguerite de Navarre (1492-1549), la sœur de François Ier qui la chérissait en l’appelant « la Marguerite des Marguerites », aimait venir aux Eaux-Bonnes pour rompre avec l'étiquette.
Aigue boune - Les Eaux-Bonnes - est située à l'entrée d'une gorge étroite et face à la Montagne Verte où se trouve le village d'Aas, connu comme le « village des siffleurs » car ses habitants, pour la plupart bergers, communiquaient entre eux sur de longues distances grâce à un langage sifflé.
C’est à la suite de son mariage en 1527 avec Henry d'Albret, deuxième du nom, fils de Jean, roi de Navarre et de Catherine de Foix, qu’elle partit rejoindre ses nouvelles terres...
Marguerite de Navarre avait-elle emporté vers son premier séjour dans la rude capitale béarnaise les chroniques dont Froissard avait enluminé la cour de Gaston Febus ?
À ce qu'il paraît, l'austérité de la bibliothèque qui l'y attendait était à l'image de la résidence de son nouvel époux, à peine un village de trois ou quatre rues avec une église, que dominait la masse gigantesque du château dressé sur son promontoire caparaçonné de pierre : la vision n'avait certes rien d'attrayant aux yeux de la délicate sœur de François Ier, accoutumée aux raffinements de l'architecture et de l'esprit de la Renaissance sur les bords de Loire...
Mais pendant que son époux Henry d'Albret, roi dépossédé de la Navarre d’outre-Pyrénées annexée par Ferdinand d’Aragon, mais resté seigneur souverain de Béarn et de la Basse-Navarre rêvait de reconquérir ses terres perdues d'outre-mont avec l'aide hypothétique de son beau-frère François Ier, Marguerite se laissa gagner par la beauté des lieux...
Femme parmi les plus instruites de son temps, Marguerite de Navarre avait fait de la cour de Navarre – ou de ce qu’il en restait après les annexions de Ferdinand d’Aragon) et de sa capitale, Pau, un foyer de l’humanisme de la Renaissance en y faisant venir les « gentilshommes les mieux faits et les mieux enlangagiés », savants, poètes, peintres et musiciens, toute une brillante élite d’artistes et de littérateurs que Marguerite nourrissait et protégeait d’une main royale, parmi lesquels son valet Clément Marot.
Et, tout en ornant de jardins le château de Pau, ou pendant ses séjours aux Eaux Bonnes, elle se plut, avec ses compagnons, "d'aller tous les jours, depuis midi jusques à quatre heures, dedans ce beau pré, le long de la rivière du Gave, où les arbres sont si feuillus que le soleil ne saurait percer l'ombre ni échauffer la fraîcheur ; là, assis à nos aises, dira chacun quelque histoire qu'il aura vue ou bien ouï dire à quelque homme digne de foi. Au bout de dix jours auront parachevé la centaine."
A l'heure où s'ébauchait ainsi l'Heptaméron, son célèbre ouvrage dans la droite lignée de Boccace, Bernat d'Etchepare, vicaire bas-navarrais de l'évêque de Bayonne et qui fut un temps emprisonné à Pau par le beau-père de Marguerite, obtenait du Parlement de Bordeaux le privilège d'éditer son « Linguæ Vasconum Primitiæ », premier livre imprimé en langue basque (1545).
traduire à Jean de Liçarrague, dans "cette langue – le basque - dont on ne croyait pas auparavant qu'elle pût être écrite, et imprimer à La Rochelle en caractères très élégants le nouveau Testament du Christ, le catéchisme et les prières usitées dans l'église de Genève".
Tels furent les débuts d'une longue et fructueuse activité littéraire en Béarn et au Pays Basque, dont l'empreinte inspira tant de grands écrivains.
A l’automne 1823, tout au fond de la vallée d’Aspe, dans la vieille forteresse du Portalet, nid d’aigle surplombant l’étroite gorge bien connue des contrebandiers et passeurs de tout genre car proche de la frontière espagnole, un jeune capitaine veille et noircit des feuilles blanches.
La trentaine à peine entamée, le comte Alfred de Vigny rêvait d’actions chevaleresques en Espagne – il s’agissait de rétablir le roi Ferdinand dans la plénitude de ses droits ; mais il a été cruellement déçu, son unité se bornant à une surveillance de la frontière aux rochers chauves et déchiquetés, un coin perdu des Pyrénées qui contrastait si étrangement avec le pays aux douceurs angevines où il avait vu le jour… En fait, il fallait interdire l’accès du territoire français à une ennemie redoutable : la fièvre jaune qui sévissait tras los montes !
Et comble d’infortune, quand le capitaine de Vigny n’est plus « en sentinelle » au fort d’Urdos, il est envoyé à Pau pour une besogne pas plus glorieuse : ce soldat quitte son métier d’apothicaire afin d’accomplir celui de policier, en particulier mater quelques jeunes gens de la ville qui créaient désordres & incidents en voulant empêcher les jeunes filles béarnaises de danser avec les soldats lors des fêtes données pour la venue de la duchesse d’Angoulême !
Et pourtant…
Notre fringant capitaine poète y connaîtra l’amour en la personne d’une beauté blonde au milieu de la montagne, Lydia, la fille d’un riche Britannique hivernant à Pau, peu convaincu par cette union, mais qu’un ami de Vigny arrivera à persuader au bout de force bouteilles de jurançon… Et comme chacun sait, un gentleman ne revient jamais sur sa parole, même lorsqu’il a juré dans l’ivresse !
La partie est gagnée, et Vigny peut épouser sa belle le 3 février 1824, en présence de quelques personnalités paloises dont le marquis de Gontaut-Biron et de notabilités britanniques : trois jours plus tard, un pasteur de l’église réformée d’Orthez apporte aux jeunes époux sa bénédiction, avant celle de l’Église catholique, plus tard, à la Madeleine à Paris.
"Je vous écris avec ma fenêtre ouverte et une jalousie fermée de peur du soleil, avec des roses en pleine terre dans mon jardin, et tout cela le 10 janvier. Quel pays !" s'exclamait Alfred de Vigny dans une lettre à Victor Hugo datée de Pau le 10 janvier 1825.
Et à ses vers : "Ô montagnes d'azur ! Ô pays adoré ! /.../ Cascades qui tombez des neiges entraînées, / Sources, gaves, ruisseaux, torrents des Pyrénées...", faisait écho la célèbre phrase de Lamartine : "Pau offre le plus beau paysage de terre comme Naples le plus beau paysage de mer."
Malgré les suites peu enthousiasmantes de son mariage avec cette Lydia qui traînera longtemps une santé chancelante, Vigny gardera toujours un souvenir ému de son séjour dans les Pyrénées qui lui paraîtront, encore quarante ans plus tard, « les plus belles montagnes de la terre » : s’il n’y avait pas conquis la gloire passagère des champs de bataille rêvés dans sa jeunesse, du moins il y avait cueilli celle, plus durable, de la poésie !
Alexandre de La Cerda évoquait précédemment l’ami de Vigny, à qui il écrivait depuis Pau en 1825 : Victor Hugo.
Si en 1811, encore enfant, le petit Victor avait séjourné vec sa mère pendant un mois à Bayonne dans l’attente de rejoindre son père, Léopold-Joseph Hugo, général de l’armée de Napoléon en garnison à Madrid pendant la Guerre de l’Indépendance Espagnole, plus tard, en 1843, Victor Hugo retourna au Pays Basque avec sa maîtresse Juliette Drouet afin de se remettre de « l’échec » de sa pièce « Les Burgraves ». Il nous reste son journal de voyage publié après sa mort sous le titre « En voyage, Alpes et Pyrénées » dans lequel il décrit surtout ses excursions sur la côte basque, de Bayonne à Saint-Sébastien, mais également à l’intérieur des terres, jusqu’à Pampelune, où il enfourcha les petits chevaux de montagne...
(Suite de la conférence d'Alexandre de La Cerda dans un prochain numéro de Baskulture)