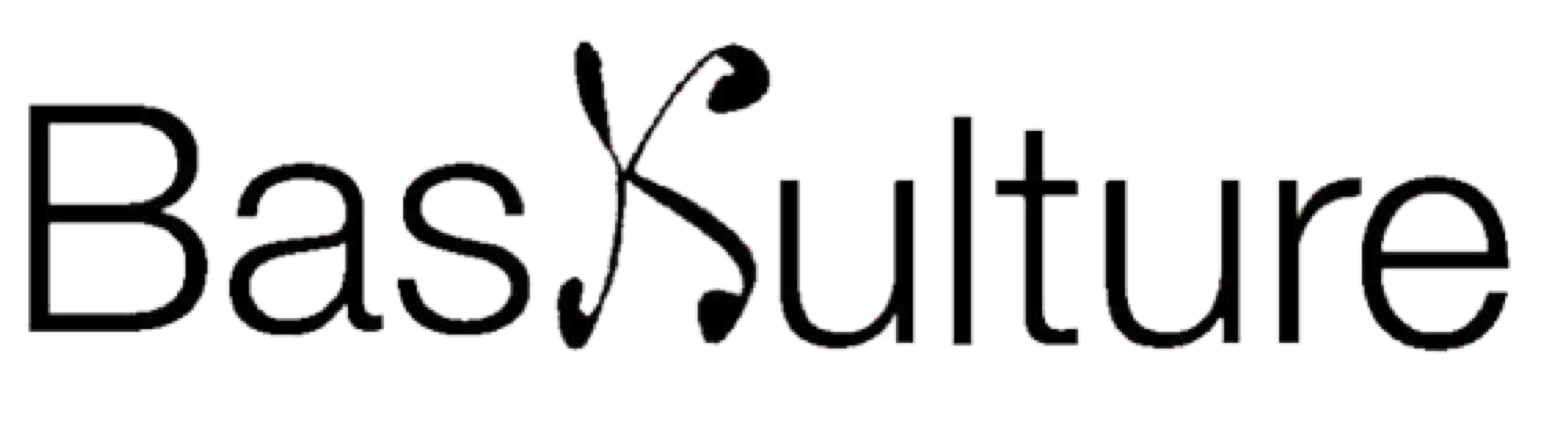Petit village, grande histoire
Par leurs nombreuses alliances dans les principaux lignages du pays et leur prestigieuse origine dans les vicomtes de Marsan - eux-mêmes issus des ducs de Gascogne - les cadets de la maison de Marsan connus sous le nom de leur terre et forteresse de Cauna en Chalosse, sont représentatifs de ces familles de la plus ancienne noblesse chevaleresque étroitement mêlées à notre histoire régionale et nationale, à travers l’inébranlable fidélité aux rois-ducs de l’Aquitaine anglaise ou l’hécatombe des interminables guerres d’Italie, les ravages des guerres de religion et de la Fronde ou encore les exactions de la Terreur révolutionnaire...
Autour de sites et de noms de légende, Poyaler, Buglose, Poyloault, le Vic-Bilh, la forêt de Mauco, l’Adour, les Navailles, Lescun, Gabaston..., à la suite du premier d’entre eux, le chevalier troubadour Arnaut-Guilhem de Marsan, contemporain d’Aliénor d’Aquitaine, jusqu’aux derniers représentants du nom toujours obstinément accrochés à leur terre d’origine, l’évêque chevalier croisé Jean de Cauna, qui mourut en Palestine dans la suite de Richard Coeur-de-Lion, y côtoie l’abbé Bordes, héros de la résistance landaise, aussi bien que le célèbre La Hire, compagnon de Jeanne d’Arc, ou le gouverneur pour le roi d’Angleterre Louis de Cauna, qui reçoit Charles VII lors de la jornada de Tartas, le capitaine aventurier Peyrot de Monluc, mort au combat à Madère, la fille de la comtesse Marguerite de Cauna, Diane d’Andoins, la belle Corisande, égérie d’Henri IV, qui fut « presque reine », et ses illustres descendants, le galant duc de Lauzun, son arrière-petit-fils, qui épousa la Grande Mademoiselle, petite-fille d’Henri IV, les comtes de Gramont, bien connus dans la région, et jusqu’aux Grimaldi, princes souverains de Monaco…, lointains descendants actuels par l’alliance de Catherine-Charlotte de Gramont, arrière-petite-fille de Corisande, et de Louis de Grimaldi. Tout autant que le bien plus humble seigneur de Ladevie, Jean de Cauna qui s’honorait de ses fonctions bénévoles de syndic et marguillier de la confrérie de Saint-Martin, dite des laboureurs tarusates…
L’un de ses aïeux, Bernard de Cauna, capitaine du château de Pau pour le vicomte de Béarn Gaston IV son cousin, s’étant allié à la sœur de ce dernier, demoiselle de la maison souveraine de Foix-Béarn-Navarre, puis dans la maison royale d’Evreux de Navarre, il était, sans le savoir sans doute, cousin des rois de Navarre et de France, mais aussi de tout le Gotha couronné européen par sa nièce Anne de Cauna, ancêtre d’Eléonore Desmiers d’Olbreuse, mère de George de Brunswick devenu roi d’Angleterre et aïeule de la grand-mère de l’Europe, la reine Victoria, et par conséquent des rois d’Angleterre, d’Espagne, de Prusse, de Grèce, de Belgique, des Pays-Bas, de Suède, de Norvège, du Portugal, de Roumanie, de Bulgarie, de Danemark, du Grand-Duc de Luxembourg et du tsar de Russie… quand l’Europe couronnée était une seule et même famille (1).
Un lointain descendant des premiers vicomtes de Marsan, un certain Henri, appelé aux plus hautes destinées eut un jour ce mot inoubliable : « Paris vaut bien une messe ». Ce millénaire d’histoire familiale gasconne mérite, lui, le détour, comme l’annonce la jaquette de présentation de l’ouvrage qui le relate dans tous ses détails qualifié d’« ouvrage de référence sur cette maison mais aussi sur l'Histoire des Landes et des familles landaises, notamment au Moyen Age »2.
Losangé d'or et de gueules : la maison gasconne de Marsan de Cauna
D'après les manuscrits d'Auch et de la Bibliothèque nationale, la paroisse de Cauna, en Chalosse, sénéchaussée de St-Sever (40), en latin Calnarium, a donné son nom à la famille qui portait le nom de Marsan, le tenant de ses auteurs les vicomtes de Marsan, descendants des ducs de Gascogne et souverains de la contrée où se trouvent les villes de Mont-de-Marsan, Roquefort-de-Marsan, St-Justin, Villeneuve-de-Marsan, Grenade et Cazères, et plus tard comtes de Bigorre et vicomtes de Louvigny (voir Marca, Oïhenard, et la Dissertation sur la maison de Foix, 1757, et Lachesnaye des Bois). Le premier porteur du nom de Cauna à apparaître dans un écrit médiéval est Achelinus-Attilius de Calnario, signataire avec bon nombre de ses parents de la charte de refondation de l’abbaye de Saint-Sever en 988 par son cousin le duc de Gascogne Guillaume-Sanche, le vainqueur des Vikings à Taller.
La baronnie de Cauna comprenait haute, moyenne et basse justice, et ses seigneurs étendirent successivement leur suzeraineté dans les Landes sur Cauna, Aurice, Mauco, Mugron, Lorquen, Poyaler, Saint-Aubin, Toulouzette, Miramont, Poy, Patin, Montaut, Poyloault, Magescq, Herm, Gourbera, Lahontan, Tilh, Misson, Caupenne..., etc. (extrait de l'Armorial des Landes, Cauna, 1865), et en Béarn, sur Abère, Escoubès, Meillon, Angos, Boeil, Assat, Astis, Aressy, Nargassie, Espoey, Horgues, Dorro, Bougarber, Cassaber…, etc (voir l’Armorial de Béarn, de Dufau de Maluquer, 1893).
L’histoire de la Maison de Cauna, l’une des plus anciennes et puissantes de Gascogne, d’extraction noble immémoriale, remonte au haut Moyen Âge. Déjà, en 1147, avant même la généralisation des armoiries, on croit pouvoir reconnaître leur blason losangé d’or et de gueules sur la monture d’un chevalier – qui pourrait être le troubadour Arnaut-Guilhem – dans une fresque de l’ancienne forteresse de Calatrava représentant le grand combat des chevaliers de cet Ordre contre les Sarrazins dans la province espagnole de Castilla-La Mancha, à la frontière avec l’Islam. Les mêmes armoiries sont encore visibles aujourd’hui, gravées dans la pierre, sur la porte de la modeste église du bourg de Cauna, ancienne chapelle seigneuriale du château, dont le donjon, réduit du tiers de sa hauteur après la Fronde, est le dernier vestige de la forteresse protégeant le gué sur l’Adour menant à Saint-Sever Cap-de-Gascogne, ancienne capitale provinciale romaine où la cour de Gascogne siégeait au palais des gouverneurs, le Palestrion. Ces armes, qui étaient également gravées dans la pierre au fronton de l’église du couvent des Jacobins avec la mention Cauna Fundator, sont aujourd’hui cachées sous l’enduit. Mais on les trouve encore en de nombreux endroits, sur la voûte de l’église de Roquefort et la muraille d’une tour de l’ancien château, sur celle de la crypte de Sainte-Quitterie du Mas d’Aire-sur-l’Adour, dans la fresque murale des blasons des évêques à la cathédrale de Dax, sur une autre (fresque votive de Poyloault) de l’église de Saint-Martin-de-Hinx, dans les blasons des villes de Tardets, de Magescq, de de Labastide-Clairence, et jusqu’à Lestiac-sur-Garonne...3
Quelques personnalités familiales, devenues personnages historiques, ont laissé plus que d’autres leur empreinte dans le récit des événements auxquels leur nom s’est attaché. L’un des premiers parmi les plus remarquables, Arnaut-Guilhem Ier, seigneur de Marsan, de Roquefort, de Montgaillard, de Cauna, de Saint-Loubouer..., et autres terres, était cousin du fondateur de Mont-de-Marsan, Pierre de Marsan, fils de Lobaner, devenu comte de Bigorre par son mariage avec Béatrix. Il était surtout un troubadour de renom, auteur de l’Ensenhamen, guide des jeunes chevaliers, très apprécié de notre duchesse Aliénor d’Aquitaine qui avait tenu à ce qu’il l’accompagne à la cour d’Espagne en 1170 pour le mariage de sa fille, une autre Aliénor ou Léonor, avec Alfonse de Castille, fils d’Alfonse VII, le vainqueur des Musulmans à Calatrava. Il était aussi très proche de Richard, futur Cœur-de-Lion, fils de la duchesse Aliénor, qu’il accompagna au siège de Dax contre son propre cousin par alliance Centulle de Bigorre allié à Pierre II de Dax, son gendre. Il était aussi cousin des Moncade, vicomtes de Béarn et de Gabarret, et des comtes de Comminges. Signataire de chartes de donation à Bayonne, aux abbaye de la Sauve et de Saint-Sever, il apparaît finalement comme l’aïeul fondateur des trois branches de la maison de Marsan : celle, aînée, des co-seigneurs de Marsan, seigneurs de Roquefort et de Montgaillard, éteinte en la maison de Pons, celle des seigneurs de Cauna, en Chalosse, subsistante en cadets du nom, et celle des seigneurs de Tardets et d’Ahaxe, en Soule, fondue dans la grande maison basque de Luxe puis de Montmorency-Bouteville et de Trois-Villes (le Tréville des mousquetaires)... ce qui donne des postérités à la fois charentaises, landaises, béarnaises et basques…
La fidélité aux rois-ducs anglais d’Aquitaine
Des dix générations constituant une longue théorie d’hommes de guerre au service des Anglais, héritiers par les ducs d’Aquitaine et Aliénor de leurs lointains ancêtres ducs de Gascogne, l’histoire a retenu ensuite la participation de plusieurs seigneurs de cette maison de Cauna, porteurs pour la plupart du prénom lignager d’Arnaud, dans les multiples chevauchées de ce qu’on appelle à tort la Guerre de Cent Ans qui dura en fait trois siècles dans notre région, mais aussi au pays de Galles et dans la guerre contre les Ecossais. C’est ainsi qu’un vicomte de Cauna (Guillaume de Marsan) est signalé en 1214 à la bataille de Bouvines, suivi d’un Arnaud de Cauna et Miramont, présent dans les années 1240-1250 à la défaite de Taillebourg puis à Bayonne et en Angleterre dans l’ost du roi-duc, lui-même suivi de son fils, autre Arnaud, fondateur du couvent de Saint-Sever, qui combat en Galles et en Béarn entre 1273 et 1283. Le suivant, Arnaud III, participe avec son frère Raymond à la guerre de Guyenne où on les trouve au siège de Saint-Sever et à la déroute de la bastide de Bonnegarde en 1295 et 1297 avant qu’il n’entrent en guerre privée contre leur voisin Bertand de La Mothe et Auger de Poudenx en 1312. Il était à la défaite de Bannockburn en 1314 en Ecosse et mourut de ses blessures peu après.
Arnaud IV de Cauna, époux d’Esclarmonde de Caupenne, reçut lui aussi plusieurs lettres de remerciements et donations de terres du Roi-duc pour ses bons services dans les guerres d’Ecosse, d’Aquitaine, d’Armagnac, et à Crécy et mourut de la grande peste en 1348. Son fils, le baron Arnaud V, accompagna le Prince Noir dans ses chevauchées et fut du contingent gascon qui se saisit à Poitiers en 1356 de la personne du roi Jean Le Bon avant d’être fait sénéchal de Marsan, mais il fut aussi des Gascons battus à Launac en 1362 et mis à rançon par Fébus. Son fils Robert dut alors épouser une béarnaise de la maison d’Espalungue en Ossau après avoir attendu longtemps que Febus lui rende ses biens et le château. Le sire de Cauna prit place alors au 2e rang des grands barons de Béarn et Marsan et participa aux sièges de Barcelonne-du-Gers et de Cazères qu’il défendit, Sault-de-Navailles, Saint-Sever, ett aux combats de la Chalosse, du Tursan et du Gabardan avec ses parents proches de Marsan, de Caupenne, de Lescun, de Béarn-Saint-Maurice, de Doazit... Son aîné, Jean de Cauna, prieur conventuel de Nerbis dont il avait bâti l’église, releva de ses ruines en 1430 la grande abbaye bénédictine de Saint-Sever dont il fut le 30ème et dernier abbé régulier.
Le cadet et héritier, Louis de Cauna, « moult noble et puissant seigneur de la Chalosse » s’allia à une demoiselle de la puissante maison des Castelnau-Tursan, descendante des vicomtes de Tursan, et se mit à la tête des seigneurs locaux pour défendre la Chalosse jusqu’au bout contre les ravages des routiers au service du sire Albret pour les Français avant de remettre en 1442, au terme d’un gentlemen’s agreement honorable, les clés de la ville de Tartas, dont il était gouverneur « anglais » pour le roi-duc, au roi Charles VII en personne qui vint ensuite dîner et coucher au château de Cauna avec son fils, le dauphin futur Louis XI et ses principaux lieutenants dont le fameux Lahire son parent. Après trois siècles de fidélité aux Plantagenêts, Louis de Cauna jura de devenir « dorénavant français lui et toute sa descendance ». Cette fameuse jornada de Tartas, marqua la fin de la guerre en Gascogne dont tous les seigneurs se réunirent à Saint-Loubouer pour y tenir leurs Etats. On y procéda au mariage de Bernard de Cauna, capitaine du château de Pau, avec Isabel de Béarn, sœur naturelle du vicomte Gaston de Foix-Béarn, pour assurer définitivement la paix dans la région. Devenu veuf, il se remaria dans une autre maison souveraine, avec Jeanne de Beaumont-Lérin-Navarre, du sang royal de France de la dynastie d’Evreux-Navarre.