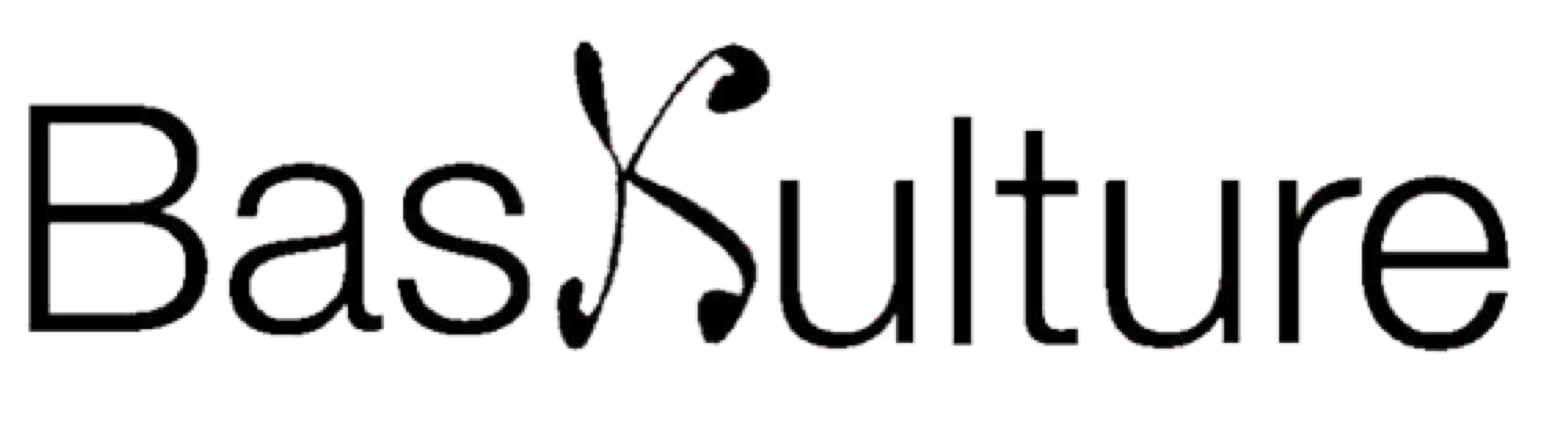Depuis 1965, Nicolae Ceausescu (1918/1989) est le secrétaire général du Parti communiste roumain (PCR). En 1974, pour la première fois, il est élu président de la république socialiste de Roumanie ; il sera réélu en 1980 et 1985. Un culte de la personnalité est encouragé par ses soins et par sa femme, Elena (1916/1989), que la propagande du régime décrit comme docteur, académicienne, et scientifique de renommée. En réalité, elle n’avait qu’une formation de couturière et une culture lacunaire. A leur service, une impitoyable police politique, la Securitate, veuille au quotidien sur la population, sur ses actes, ses pensées. La moindre déviance détectée est, sans tarder, réprimée. Un proverbe roumain dit qu’un roumain sur dix est un policier, qu’un sur quatre est un mouchard, et qu’un sur deux est alcoolique. Dans le cadre d’un culte de la personnalité délirant Nicolae Ceausescu devient « le Conducator », « le génie des Carpates », « le Danube de la pensée », etc. Ce couple infernal, par ses extravagances (politiques, économiques, morales), enfonce leur pays dans une crise sans fin.
Le 16 décembre 1989, éclatent des émeutes dans la ville de Timisoara à l’ouest de Bucarest. C’est une ville multiculturelle, aux minorités influentes, qui se révolte contre la politique de « systématisation » imposée par le pouvoir dictatorial de Bucarest : raser des quartiers historiques (églises, édifices classés, maisons, etc.) pour les remplacer par des immeubles d’habitations standardisés ou d’imposants bâtiments administratifs. La « systématisation » devrait permettre l’édification d’une « société socialiste multilatéralement développée. ». Le couple ubuesque, Nicolas et Elena Ceausescu est adossé à une nomenklatura complice, tous deux protégés par un appareil policier, la Securitate. Associés, ils prônent cette politique à laquelle s’ajoute un programme d’austérité lancé en 1981 (remboursement, aux forceps, de la dette extérieure ; exportation de toute la production agricole, etc.).
Le 17 décembre 1989, l’armée est envoyée à Timisoara par le « Conducator » afin de mater les émeutes. Cette dernière ouvre le feu sur la population. Le chaos s’installe. La loi martiale est promulguée. A Bucarest, grâce aux stations de radios occidentales, écoutées malgré la censure, les roumains prennent connaissance des évènements …
Dans les studios de la télévision nationale roumaine des hommes s’affairent devant des écrans. Ils visionnent et revisionnent une séquence chantée du programme de fin d’année, enregistrée auparavant dans un décor spartiate, toute à la gloire du « Conducator ». Problème : l’interprète principale s’est depuis refugiée à l’ouest ou elle a pris la parole sur les antennes de Radio Free Europe/Radio Liberty. Avec la disparition de la chanteuse, la séquence est indiffusable. Comment y remédier : le temps presse !
Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé est le premier long métrage réalisé par Boddan Muresanu (61 ans) dont il est également le scénariste. En effet, il a « cousu » six histoires sur les deux jours qui précédent la chute brutale de Nicolas Ceausescu et … de son régime (?). La forme retenue est celle d’un kaléidoscope de gens ordinaires brusquement plongés dans une situation extraordinaire. Ces six roumains vivants sous le joug d’un pouvoir kafkaïen sont : Stefan Silvestru (Mihai Calin) un réalisateur de télévision, et Laurentiu (Andrei Miercure) son fils rebelle, Florina (Nicoleta Hancu) une actrice de théâtre, Gelu (Adrian Vancica) un simple ouvrier, Ionut Dinca (Iulian Postelnicu) un policier austère et sa mère Margareta (Emilia Dobrin) une veuve suicidaire.
Dans ce film choral ces personnages se croisent dans une pharmacie, dans un taxi, dans la rue, sans se connaitre, cloisonnés par l’angoisse, la peur, persuadés d’être surveillés, bientôt dénoncés à la vindicte publique. Tous vivent au jour le jour, sous une menace prégnante et diffuse, d’autant plus terrifiante.
Le cinéma roumain renaissant, après la chute du « Conducator », a déjà traité l’enfer de ce régime grand-guignolesque : 4 mois, trois semaines, deux jours (2007) de Cristian Mungiu, Palme d’or au Festival de Cannes, sur des tentatives d’avortement d’une étudiante avec l’aide de sa colocataire ; 12h08 à l’est de Bucarest (2006) de Corneliu Porumboiu mettant en scène (déjà) une équipe de télévision. Bogdan Muresanu pousse le bouchon plus loin en décrivant, sous la forme tragi-comique, six personnages englués dans les filets d’une société incongrue, sans avenir. Le système des chassés-croisés des personnages rappelle celui (vingt-deux personnages principaux !) de Short Cuts (Lion d’or en 1993 à la 50ème Mostra de Venise) du réalisateur américain Robert Altman (1925/2006).
Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé est certes moins ambitieux, faute de moyens financiers, mais il n’en reste pas moins remarquable. Le film est enregistré en format carré (4/3), caméra mobile à l’épaule, dispositif qui en restreignant le cadre, enserre les protagonistes dans un univers quasi carcéral sombre, aux couleurs « sales » (marrons, verdâtres, etc.), quelques soient les lieux (studio de télévision, théâtre, appartements). La société idéale, suivant le « régime communiste », est pour le moins déprimante.
Lors d’un entretien avec le réalisateur au sujet de son long métrage (le film est en tête du box-office roumain), ce dernier déclare : « Cette atmosphère de fin de règne a déjà été scrutée par de nombreux cinéastes roumains mais j’ai la sensation qu’il n’y en a pas autant qu’on ne le pense et mon approche, ce kaléidoscope au ton tragi-comique, offre une perspective différente sur la révolution ». C’est exact !
Ce nouvel an qui n’est jamais arrivé est un bijou de drôlerie et d’absurdité dans la tradition roumaine de l’humour noir. Autrement dit, comment survivre dans une société entravée dans des rets idéologiques maniés par des incapables, incultes de surcroit. Imbécilité de vouloir faire accéder les roumains au bonheur … malgré eux ! En conclusion, le premier opus de Bodgan Muresanu est sans discussion, une œuvre salutaire.