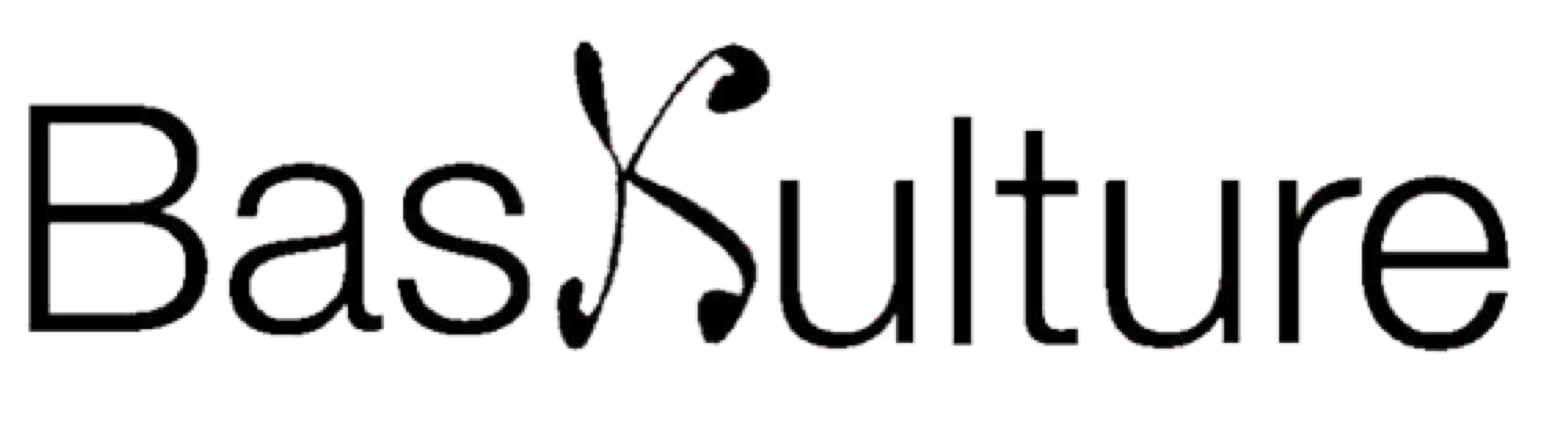« - J’ai soif de cette eau-là, dit le petit prince, donne-moi à boire…
Et je compris ce qu’il avait cherché ! »
« C’est comme pour l’eau. Celle que tu m’as donnée à boire était
comme une musique, à cause de la poulie et de la corde… tu te
rappelles… elle était bonne. »
« Cette eau était bien autre chose qu’un aliment. Elle était née de la
marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l’effort de mes
bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. »
Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943.
Car, c’est en venant qu’ils virent.
« Il n’est point de plus grande douleur que de se souvenir
des jours de félicité dans la misère… » (1).
Amour m’a poussé, qui me fait marcher vers Compostelle. Tant d’êtres vont rivés l’un à l’autre, pourtant solitaires. Ils sont les voyageurs errants de leur amour, assourdis par le tumulte de leur cœur ; ils n’habitent point leur amour. Ils vont comme crucifiés l’un contre l’autre. « Jamais ne les réconforte nulle espérance » (2).
Dans Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi (2014), Jean-Christophe Rufin écrit que pour ceux qui marchent, le Chemin a cette vertu étrange d’effacer les raisons du départ. Que l’on ne se souvient plus vraiment pourquoi l’on est parti. Que ce n’est pas l’homme qui prend le Chemin, mais le Chemin qui prend l’homme. L’homme dit : « je suis parti, voilà tout ». C’est beau, mais faux. L’amour, dit saint Denis (3), nous place comme en dehors de nous-mêmes et nous transforme, de certaine façon, en l’objet aimé. Si l’être aimé devait être oublié, ce serait s’oublier soi-même — comme si l’on mourait à soi-même ; c’est même plus, car on vit plus en l’aimé qu’en soi-même … La mémoire meurt de l’absence de l’être aimé.
Pourtant, le Chemin efface. Il ne nous vide pas, il ne fait pas table rase. Il nous racle doucement de l’intérieur. Il lave. Il déplie. Il rend à nu. Il y a un oubli, oui — mais un oubli qui prépare une mémoire plus haute, plus claire. Dante le savait, lui qui fit boire à son pèlerin deux eaux pour le préparer à la lumière de la rencontre au-delà du feu purificateur. L’une, le Léthé, efface toute trace du péché. L’eau du Léthé n’agit que sur les souvenirs des fautes commises. L’autre, l’Eunoé, rend à l’âme la mémoire des bonnes actions accomplies. Sans l’une, on ne peut plus avancer. Sans l’autre, on ne sait plus pourquoi on monte.
Et c’est là que naît l’espérance. Cette petite espérance qui étonne tant Dieu. Cette petite flamme tremblante, vacillante et anxieuse qui traverse toutes les épaisseurs de nos nuits. La mémoire, devenue humble, n’accuse plus, elle n’exige plus, elle se souvient en silence du feu pour lequel elle est faite. L’espérance, dit saint Jean de la Croix, c’est ce désir nu, ce manque creusé au plus profond du cœur, non plus brûlant d’avoir, mais consumé par l’absence offerte. Elle est mémoire purifiée : non plus le souvenir figé de ce qu’on a perdu, mais le pressentiment doux de ce qu’on va recevoir.
Une mémoire qui ne s’attarde plus sur les détails de la blessure, mais qui sait — sans savoir comment — que tout cela a un sens. Et que ce sens descend d’une étoile. Le Chemin est cela : une double eau. Il lave et il réveille. Il fait oublier pour mieux révéler.
On croit avoir oublié pourquoi l’on est parti, et voilà qu’un jour, au détour d’une chapelle ou d’une lumière sur un toit de tuiles rouges, cela revient — non comme une explication, mais comme une paix qui vous envahit. Ce n’est donc pas tout à fait vrai qu’on ne sait plus pourquoi on est parti. C’est juste que, sur la route, le cœur a changé de langue. Il ne parle plus comme avant. Et quand il se tait enfin, c’est qu’il est — peut-être — prêt à monter aux étoiles.
Il y a des buts — invisibles, qui ne se donnent pas sans une certaine fidélité — firmitas (4) … comme celle du Petit Prince pour sa fleur, « rose qui rayonne en lui comme la flamme d’une lampe, même quand il dort… ». On marche comme on a soif ; « — J’ai soif aussi… cherchons un puits… ». Compostelle peut être bon pour le cœur. Il faut marcher avec le cœur. Les pieds sont aveugles.
« Moi, se dit le petit prince, si j’avais cinquante-trois minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine… » (5).
De hoc altari (utero Mariae) ad aram crucis ascendens (6)
« Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? »
(Jean 3, 1-15)


Ici, commence la via Podiensis, par le sein de la Vierge (utero Mariae) qui a fait naître l’Agneau monté sur l’autel de la Croix (ad aram crucis ascendens). Le chemin commence là, dans le secret d’une chapelle enfouie sous la cathédrale du Puy, au creux d’une pierre qu’on appelle encore la « pierre des fièvres », mais qui pourrait tout aussi bien s’appeler pierre de conception.
C’est là, dans le silence compact de la pierre et de la foi, que s’ouvre la marche. On entre par le sein de la Vierge, celle qui a porté dans son silence celui qui allait devenir pain pour le monde. Et c’est là le mystère que peu osent dire : le Christ n’est pas monté sur la Croix depuis les hauteurs du ciel, mais depuis la chair de Marie, depuis ce sein caché qui fut le premier autel.
La Croix ne fut pas le commencement du don, mais son accomplissement.
Le Chemin, lui, commence en amont, dans ce mystère de la chair offerte avant même d’être crucifiée. Marcher vers Compostelle, c’est suivre un mouvement eucharistique inversé : on part du sein pour aller vers la Table. On quitte la matrice mariale pour communier au don total. On marche à rebours du mystère, non pour remonter le temps, mais pour entrer plus profondément dans la sagesse de l’amour : celle où le Pain de Vie a été pétri dans le corps d’une femme.
Ce n’est pas une route comme les autres.
Ce n’est pas un départ comme les autres.
Ce n’est pas une pierre comme les autres.
Ce n’est pas un pas comme les autres.
Ce n’est pas un silence comme les autres.


Car on ne commence pas la via Podiensis par hasard.
Parce que la via Podiensis, elle ne commence pas sur la place.
Parce que la via Podiensis, elle ne commence pas dans les jambes.
Elle commence dans le sein d’une femme.
Et cette femme, ce n’est pas n’importe quelle femme.
Ce n’est pas une mère parmi les mères.
Ce n’est pas une vierge parmi les vierges.
C’est Marie.
Elle a porté dans son silence ce que le monde n’aurait jamais pu contenir.
Elle a porté dans sa chair celui qui devait monter sur l’autel.
Et l’autel, ce n’est pas seulement celui de bois,
Et l’autel, ce n’est pas seulement celui du calvaire,
Et l’autel, ce n’est pas seulement celui de pierre.
C’est aussi le sein.
C’est d’abord le sein.
C’est le premier autel.
C’est l’autel vivant.
Car avant que l’Église ne dise : ceci est mon corps,
Marie l’avait déjà dit,
en silence,
avec son sang,
avec sa chair.
Et dans ce oui nu, radical, total,
dans ce oui sans retour, elle a donné Dieu au monde.
Et elle a donné au monde l’hostie que le monde allait crucifier.
Et elle a donné au monde l’hostie que le monde allait manger.
Et elle a donné au monde le Pain de Vie.
Alors le pèlerin, quand il pose le pied sur la première pierre, il ne sait pas.
Mais il entre dans un mystère plus ancien que lui.
Il entre dans une chambre close.
Il entre dans une matrice de feu.
Il entre dans un commencement eucharistique.


Et ce n’est pas un pas. C’est une offrande.
Et ce n’est pas une marche. C’est une montée.
Et ce n’est pas un mouvement. C’est une messe.
Et le pèlerin marche.
Et il croit marcher pour se vider.
Et il croit marcher pour oublier.
Et il croit marcher pour aller quelque part.
Mais il ne sait pas encore qu’il marche pour revenir.
Revenir à l’origine.
Revenir au feu premier.
Revenir à la chambre close.
Revenir au premier battement du monde.
Tout pèlerin commence là, même sans le savoir,
Dans une matrice de feu et d’espoir.
Avant la marche, avant même l’appel,
Il repose un instant entre le sein et l’autel.
Et alors il marche.
Et il monte.
Et il descend.
Et il pleure un peu.
Et il sourit parfois.
Et il ne comprend pas.
Pas tout de suite.
Mais un jour, sur une pierre ou sur un silence, dans une montée ou dans un souffle, sans y penser, sans vouloir comprendre, sans chercher à nommer, en marchant, il voit.
Il voit que le Chemin ne commence pas devant lui, mais en lui, qu’il ne commence pas au Puy-en-Velay, mais dans le sein d’une femme, qu’il ne mène pas seulement à un tombeau, mais à un autel, qu’il ne finit pas sur une place, mais dans une messe.
Et ce jour-là, il ne dit rien.
Il y a des choses qu’on ne dit pas.
Parce qu’elles ne veulent pas être dites.
Elles veulent être portées.
Marchées. Silencieusement.
Il continue de marcher.
Mais le silence qu’il porte n’est plus le même.
Surge et ambula !
« Mais celle dont j’attends le quand et le comment pour parler ou me taire, est impassible ; c’est pourquoi, contre mon désir, je fais bien de ne rien demander ».
« Alors celle qui voyait mon silence dans le regard de celui qui voit tout, me dit : « Satisfait ton brûlant désir». »
Le Paradis – Chant XXI


Je suis arrivé au Puy-en-Velay le jour de la Saint-Thomas d’Aquin. Il faisait beau, mais la lumière ne brillait pas seulement au-dehors. Le lendemain matin, la ville respirait sous un manteau d’ombre et d’encens. Un léger vent effleurait les pierres comme une prière oubliée. J’étais arrivé sans bruit, comme on arrive parfois à soi-même, sans fanfare ni certitude.
Dans une chapelle étroite, presque secrète, une pierre basaltique m’attendait. Noire. Silencieuse. Froide comme le seuil. Je me suis allongé. Non pour demander, mais pour déposer. Déposer mes fièvres anciennes : le doute, l’amour, le temps. Tout ce qui brûle et encombre. La pierre était froide, oui — et pourtant vivante. Sous elle, battait quelque chose. Une flamme cachée. Une mémoire plus vieille que moi. Et sans mot, sans miracle éclatant, je suis ressorti. En allongeant mon corps sur cette dalle, j’ai entendu, à travers le poids du monde, le battement ancien d’une parole qui ne criait pas mais portait :
« Lève-toi, prends ton grabat, et marche. » (Jean 5,8) Ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει
Et maintenant, je ne sais plus si j’ai marché ou si j’ai été porté. Je ne sais plus si j’ai cherché ou si j’ai été trouvé. Tout ce que je sais, c’est qu’en partant de ce lieu — de cette pierre, de ce sein — quelque chose de merveilleux a commencé en moi que je n’ai pas décidé. Quelque chose qui ne m’appartient pas, mais qui me façonne. Je croyais prendre le chemin. Je comprends qu’il m’a pris. Oui, c’est le Chemin qui fait l’homme. Mais, je comprends qu’il m’a voulu avant que je le veuille. Et qu’en passant par ce sein, je suis entré dans le souffle du don. Pas un sacrifice. Un abandon. Une confiance absolue. Je ne marche plus pour aller quelque part.
Je marche parce qu’un Autre me porte. Et dans chaque pas, désormais, il y a un Autel. Chaque montée est une offrande. Et dans chaque silence, une mémoire du sein d’où tout vient. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je suis né une seconde fois. Là — une naissance plus ancienne que la première.


Eric Trelut, Gabat
Τί ζητεῖτε; — Quid quaeritis ? « Jésus se retourna, vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent :
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
Il leur dit :
« Venez, et vous verrez. »
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là ; c’était environ la dixième heure ». (Jean, 1, 38-39).
Notes :
(1). « Nessun maggior dolore, che ricordarsi del tempo felice, nella miseria… » Dante Alighieri, Divine Comédie, Enfer, chant V. Plainte de Francesca.
(2). Dante Alighieri, Divine Comédie, Enfer, V, 44.
(3). De div. nom., chap. 4, cité par saint Thomas, Somme théologique, Ire partie, question XX, article 2.
(4). La marche peut être comparer à un élan architectural : faire un pas après l’autre, jour après jour, c’est déjà s’engager dans un processus de construction qui nous identifie au bâtisseur de cathédrales. Le grand architecte romain Vitruve distinguait, dans De Architectura, la firmitas d’un édifice de son utilitas ou de sa venustas. Tout édifice, écrit-il, répond à trois impératifs : l’utilitas (l’utilité), ce à quoi l’édifice est destiné en tant que tel ; la venustas ou sa beauté propre à émouvoir.